Criminalité réelle : équation et réflexions
Publié par BD-SLL
Nous remercions les professeurs Marie-Sophie Devresse et Laurent Van Ruysevelt pour leurs lectures et leurs commentaires qui ont permis d’améliorer ce texte.

- Adam Ch., Cauchie J.-Fr., Devresse M.-S., Digneffe Fr. et Kaminski D., 2014, Crime, justice et lieux communs. Une introduction à la criminologie, Bruxelles, Larcier.
- De Rue M. et De Valkeneer Ch., 2008, Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête. Analyse des lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005 et de leurs arrêtés d’application., Bruxelles, Larcier.
- Foucault M., 1975, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Saint-Amand, Gallimard.
- Fourez G., 1988, La Construction des Sciences. Introduction à la Philosophie et à l’Éthique des Sciences, Bruxelles, De Boeck.
- Robert Ph., 1977, « Les statistiques criminelles et la recherche. Réflexions conceptuelles », Déviance et Société, vol. I, n°1, p.3-27.
Organisation(s) policière(s)
Publié par BD-SLL
Toute police agissant au sein d’un espace donné demande à être analysée dans trois de ses caractéristiques majeures : dans l’histoire politique du cadre national centralisé et/ou décentralisé au sein de laquelle elle s’enracine ; en tant qu’institution soumise aux multiples contrôles d’autres instances (politiques, judiciaires, citoyennes et pairs) en raison de la spécificité du pouvoir octroyé à ses agents : l’usage monopolisé de la force légitime ou bien « le mécanisme de distribution d’une force coercitive non négociable mis au service d’une compréhension intuitive des exigences d’une situation » (Bittner, 1980) ; et en tant qu’organisation administrative, civile et/ou militaire, qui met en œuvre différents mandats ou missions selon des modalités d’action qui lui sont propres.
S’il existe des modèles (patterns) de police bien différents les uns des autres dans des nations développées de niveau comparable, au-delà de leurs différences culturelles et de leur dé-différenciation d’avec l’État (Badie, Birnbaum, 1979), se pose immanquablement la question de savoir qui y détient réellement le pouvoir de police. À ce sujet, on observe une ample constellation de configurations possibles (Bayley, 1990) : des organisations dénommées « police » peuvent présenter des fonctions différentes selon les pays (polices administratives, polices judiciaires, polices parallèles…) ; des organisations différentes (polices militaires, polices civiles) peuvent accomplir des missions de police dans un même pays ; des services de police peuvent accomplir des tâches non policières (travail social), tandis que des tâches policières peuvent être accomplies par du personnel non policier (sécurité privée, Ocqueteau, 2004 ; neighborhood watch commitees, Rosenbaum, 1986).
C’est le poids de la longue histoire politique de chaque nation qui fait varier et explique le style des configurations rencontrées. Et si l’on a tort d’opposer de façon rigide un « modèle » continental latin (avec la France comme idéal-type) à un « modèle » décentralisé de common law et de policing by consent (Royaume-Uni), cette distinction reste néanmoins heuristique pour pouvoir évaluer l’impact réel de la production de la sûreté (security) dans chacune des aires nationales. Des polices plus ou moins professionnalisées agissent certes dans les « États de droit » où les règles du jeu des recrutements sont relativement transparentes (sélection des candidats par les concours et scolarités dédiées). Mais c’est leur policing (art de policer) qui diverge dans les différents modèles à cause de la manière dont on y conçoit la redevabilité (accountability) de l’action de leurs agents. À la différence d’une idéologie en vogue dans les années 1970 qui dénonçait une « armée de droit peuplée de mauvais juristes » (Gleizal, 1974) au vu de la médiocrité des compétences policières, on remarque plutôt aujourd’hui la persistance d’une différence dans la reddition des comptes des tâches accomplies au quotidien par des polices mieux averties de leurs droits et devoirs : les unes sont plutôt enclines à se tourner vers les hiérarchies administratives centrales (Intérieur, Défense), les autres plutôt vers les échelons de pouvoir décentralisés (maires et populations locales).
De cette mécanique différenciée de la redevabilité diffèrent à la fois les sources de la légitimité policière et la nature de sa politisation. Au sein des deux modèles, le rapport de l’organisation policière au politique se déduit soit d’une inférence de la police étatisée en étroite osmose avec l’équipe dirigeante qui sélectionne des élites de sensibilité identique aux siennes pour les placer au sommet de directions centrales, soit d’une inférence de la police communautaire plus en phase avec les attentes du pouvoir local. Les États tentent de réagir aux deux foyers des dérapages possibles de la politisation (sédition et corruption) en s’accommodant de systèmes de police duels ou univoques. À la différence des pays de tradition de common law où décentralisation, pouvoir judiciaire et emprise de l’habeas corpus s’imposent beaucoup plus fortement à la seule police civile, les systèmes centralisés romanistes présentent plus volontiers des structures policières duelles censées provoquer des contrepouvoirs internes pour diminuer leur influence sur le régime politique (France, Italie, Espagne).
Observons comment évolue l’ancestrale coexistence d’une Gendarmerie (militaire) et d’une police nationale (civile) pour assurer l’ordre public français - une coexistence souvent présentée comme un moyen aux mains du pouvoir central pour mieux lutter contre les foyers de subversion internes, en jouant de leurs différentes loyautés et de leurs rivalités. Aujourd’hui, les différences du modèle dualiste hérité de l’Ancien Régime puis de la Révolution de 1789, tendent à s’atténuer (Berlière, Lévy, 2011) : en effet, les deux grandes institutions régaliennes qui incarnent la force publique à la ville (Police nationale) ou à la campagne (Gendarmerie nationale) sont désormais considérées, en ce début de XXIe siècle comme accomplissant des missions identiques et complémentaires plutôt que véritablement opposées. Une réforme de 2009 a entériné cette tendance irrésistible à la convergence en rattachant fonctionnellement les deux administrations sous l’autorité d’un seul ministère, l’Intérieur, tout en laissant à la Défense le soin de gérer les carrières militaires des gendarmes. Ce mouvement de rapprochement signifie que les grandes orientations relatives à la sécurité sont désormais considérées comme œuvrant à des défis identiques.
Police et Gendarmerie nationales, quand elles coexistent, sont confrontées à des défis similaires, depuis notamment que les États évaluent leur productivité sécuritaire selon des normes managériales importées de l’univers de la libre entreprise, en développant des outils de mesure communs : en sécurité des personnes, des biens et de l’information, on évalue le travail des brigades de la gendarmerie départementale comme celui des directions départementales de sécurité publique ; en maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l’immigration clandestine, on évalue leurs parts respectives en polices aux frontières ; dans la lutte contre le crime organisé, les grandes délinquances et les trafics de stupéfiants, on évalue le travail des équipes, brigades et actions de recherches de la gendarmerie tout autant que celui des unités de police judiciaire pour la police ; dans le domaine du maintien de l’ordre public, autant les performances des Compagnies Républicaines de Sécurité que celles de la Gendarmerie mobile ; enfin, en protection du pays contre les menaces extérieures, intérieures et le terrorisme, on évalue la contribution de la direction centrale du renseignement intérieur et de la direction générale de la sécurité extérieure.
En dépit de la sophistication des organigrammes qui prédisposent à voir des administrations en miettes, aux sous-cultures spécifiques si cloisonnées qu’elles risquent à tout moment de générer des effets contre-productifs, on ne peut raisonnablement pas soutenir que l’organisation policière serait réductible à une anarchie organisée (Friedberg, 1997) dont l’ordre apparent cacherait le plus grand désordre. En effet, dans toutes les nations développées, l’organisation policière offre bel et bien des régularités de fonctionnement identiques, tant dans les structures sous-jacentes de l’action collective que dans les processus de régulation ou d’institutionnalisation. L’action collective à laquelle les acteurs de police sont confrontés dans leur métier, à titre principal ou accessoire, explicite ou secret (Laurent, 2009), se résume à trois missions transversales qui façonnent l’essentiel des identités : la police du sommeil (sécurité et paix publiques), la police criminelle (police judiciaire), et la police de souveraineté (renseignement et information) (Monjardet, Ocqueteau, 2004).
La première mission visant à assurer l’ordre quotidien local, autrement dit la tranquillité et la salubrité, a pour objectifs de dissuader les passages à l’acte et de prévenir les petits désordres dans l’espace public par le biais d’une bonne interconnaissance des îlotiers avec la population des lieux de leur contrôle et de leur surveillance. La seconde, longtemps considérée comme une auxiliaire de la justice chargée des basses besognes contre le crime par sa connaissance intime du « milieu », a progressivement autonomisé et scientificisé ses techniques d’enquête en étendant notablement le champ de ses compétences spécialisées (Lévy, 1987). Elle se déploie moins sur une aire géographique précise qu’elle ne se soucie d’adaptation de son fonctionnement en pôles et en réseaux (Bigo, 1996), en reproduisant la localisation des grandes délinquances qui débordent les frontières (Sheptycki, 2005) et en traquant les vecteurs/acteurs de vulnérabilités sur les réseaux virtuels (Leman-Langlois, 2008). La police de souveraineté, historiquement la plus ancienne (L’Heuillet, 2001 ; Napoli, 2003), trouve, quant à elle, son unité dans une égale dépendance à l’égard du Prince ou de l’État dont il lui revient d’assurer la protection et le conseil. Cette police (politique, au sens noble du terme) serait d’ailleurs la seule des missions dont on peut soutenir qu’elle incarnerait la « force publique », une force régalienne intrinsèquement assimilable à l’essence de l’État. En effet, elle assure et conforte la souveraineté dans le champ intérieur, regroupe des missions de contrôle des excès des populations sur le territoire national, informe le pouvoir sur les menaces extérieures et intérieures potentielles qui se trament, maintient l’ordre public par le contrôle et la contention des manifestations de masse en fluidifiant l’espace public pour pouvoir garantir, en période troublée, la continuité du fonctionnement de ses services. Son territoire d’exercice est donc la nation entière, et son organisation matérielle, en privilégiant mobilité et disponibilité de ses troupes, se traduit par une capacité d’intervention massive et instantanée sur n’importe lequel de ses points.
Monjardet (1996) a proposé une typologie restée sans égale pour rendre compte des implications dynamiques des trois grands modes de production de l’organisation policière d’ensemble, valable dans tous les pays de développement comparable.
|
|
ORDRE POLITIQUE
|
RÉPRESSION DU CRIME
|
SÉCURITÉ PUBLIQUE
|
|
Approvisionnement
|
|
|
|
|
Source
|
Ministre, préfet, directeur, parquet
|
Juge d’instruction
Victime
|
Public
|
|
Forme
|
Ordre
|
Réquisition / Plainte
|
Sollicitation / Appel
|
|
Référence
|
État (institution)
|
Justice
|
Citoyen
|
|
Objet
|
|
|
|
|
Cible
|
Adversaire (opposition)
|
Criminel (déviance)
|
Perturbation
(événements, incivilités)
|
|
Territoire
|
Nation
|
Pôles et réseaux
|
Local
(agglomération, quartier)
|
|
Objectif
|
Maintien de l’ordre
|
Élucidation
|
Sécurité / Tranquillité
|
|
Critère
|
Moindre coût
|
Statistique (performance)
|
Sentiment
|
|
Ressources
|
|
|
|
|
Outil
|
Force, surveillance
|
Information, enquête
|
Autorité
|
|
Qualification
|
Discipline
|
Expertise
|
Discernement
|
|
Mode d’acquisition
|
Collectif
|
Savoirs techniques
|
Expérience
|
|
Fonctionnement
|
|
|
|
|
Organisation
|
Militaire
|
Professionnelle
|
Artisanale
|
|
Principe d’action
|
Légalisme
|
Performance, prouesse
|
Service
|
|
Principe de sélection
|
Faible
|
Fort (priorités)
|
Fort (opportunités)
|
|
Moteur
|
Prince
|
Intérêt professionnel
|
Demande sociale
|
|
Sanction
|
|
|
|
|
Contrôle
|
Hiérarchique externe (pouvoir)
|
Hiérarchique interne (experts, profession)
|
Collectif
(déontologie)
|
|
Rétribution
|
Matérielle
|
Notoriété, Prestige
|
Popularité, Confiance
|
|
Faute (accident)
|
Disproportion, Visibilité, Scandale
|
Erreur judiciaire
|
Abstention, Saturation
|
|
Perversion
|
Milice
(au-dessus des lois)
|
Justicier
(escadron de la mort)
|
Travail social
(en-deçà de la loi)
|
Source : Dominique Monjardet, Ce que fait la police, sociologie de la force publique, Paris, La Découverte, 1996, p. 140.
Quand on différencie l’institution policière (l’usage de la force qui la distingue de beaucoup d’autres institutions) de son organisation empirique, c’est-à-dire des modalités concrètes d’investissement au travail de ses propres agents, on perçoit mieux les caractéristiques générales qui les apparentent à d’autres collectifs au travail comme dans l’armée, à l’école ou l’hôpital par exemple (Bernoux, 2009). La force de travail peut se décrire dans chacun de ces univers organisationnels de deux façons. De façon formelle dans ce que l’organisation est censée être, sous la forme d’organigrammes, de définitions de tâches, d’instances et de programmes, de règles et de procédures, de rapports et de bilans. Mais d’une façon informelle, tout autant. Tous ces collectifs fonctionnent autrement que ce qui est dit sur le papier : les organisations ne marchent que si leurs agents procèdent en permanence à des ajustements réciproques, jugent avec discernement les situations, saisissent des opportunités ou suspendent des contraintes, anticipent et corrigent leurs actions en situation de rationalité limitée. S’ils arrêtent de travailler en se livrant à une grève du zèle par exemple, toute l’organisation se trouve instantanément paralysée. L’organisation est avant tout le fruit d’un ensemble de micro ajustements et d’interprétations opportunes des règles permettant à ses membres de s’adapter à l’infinie variété des conjonctures, par-delà ou en-deçà des missions que leur assignent les organigrammes et les tableaux de bord en termes de rendements quantifiés. Les gardiens de la paix négocient informellement leur propre autorité dans la rue avec les contrevenants (Monjardet, 1994) ; ils mobilisent des savoir-faire empiriques et routinisés par la coutume, hérités de l’édification des anciens ou de pairs plutôt que par les savoirs scolaires (Tiévant, 2001) ; au sein des équipages urbains en civil ou en tenue ils mobilisent toute la gamme des savoirs formels et informels disponibles, armes physiques autant qu’intellectuelles pour ne pas perdre la face dans les cités sensibles (Boucher et alii, 2013) ; les cadres négocient téléphoniquement avec leurs homologues du parquet et de la préfecture la mise en œuvre pratique de la sécurité publique générale (Gatto, Thoenig, 1993).
Bref, à tous les étages de la hiérarchie de l’administration, les agents de police sont plus que tous autres fonctionnaires pris dans l’étau de la tension de la force et du droit. Et c’est dans ce domaine que la grammaire normative de l’organisation est la plus développée et la plus contraignante, beaucoup plus que dans n’importe quel autre univers non régalien. Mais contrairement au professionnalisme des CRS dans les techniques du maintien de l’ordre, les aléas des événements ordinaires dans l’espace public des gardiens de la paix exigent du sang-froid et du discernement constants, sans sombrer dans les pièges de la routine. La métaphore du chèque en gris « rédigé en des termes généraux et encaissé en opérations particulières dans une dissymétrie censée protéger à la fois l’émetteur et l’encaisseur » (Brodeur, 2003, 41) rend particulièrement bien compte de la tension vécue par le haut et par le bas.
Au niveau top down, les directions policières de la sécurité publique sont inévitablement confrontées au tabou d’un dilemme quasi insoluble entre la règle et la pratique (Reiner, 1991 ; Ocqueteau, 2006). Ou bien, elles choisissent d’ignorer l’informel et de diriger leurs services en ne faisant référence qu’aux règles explicites. Mais c’est au prix de voir les écarts se creuser, de se voir décrédibilisées, de voir se dégrader la qualité des relations collectives, se généraliser la rétention d’informations ou de voir les indicateurs d’activités manipulés (Matelly, Mouhanna, 2007). Ou bien, elles se donnent les moyens d’expliciter et d’assumer le fonctionnement réel de la machine à produire de la sécurité et d’en assumer les conséquences en termes d’involution des buts en couvrant les pratiques réelles du niveau bottom up plutôt que de les paralyser, au risque de menacer la légitimité de la pyramide des normes bureaucratiques verticales. Cette tension perpétuelle tend à se résoudre selon deux modalités d’action constantes : par le haut, en transformant le style des leaderships pour mieux susciter l’adhésion du collectif aux volontés des hiérarchies ; par le bas, en s’enrôlant dans une cohésion syndicale corporatiste pour résister à l’hostilité du monde environnant et à la pression des hiérarchies.
S’agissant du style du leadership, on cherche la bonne formule capable de susciter l’adhésion, et c’est dans la pratique judicieuse du leader autoritaire ou managérial qu’on espère voir se résoudre temporairement la tension entre la règle formelle et informelle au sein des services de police (Adlam, Villiers, 2003). On n’y parvient que si le leadership s’accompagne d’une pédagogie sachant détecter parmi les agents comment les normes déontologiques de soft law font l’objet des meilleures pratiques de discernement sur le terrain et aux guichets. La différence d’intériorisation des normes déontologiques ressortant du savoir-être constitue d’ailleurs une preuve de la pluralité des identités policières dans des contextes empiriquement comparables : certaines nations mettent plutôt l’accent sur les impératifs d’un « service public » égalitaire, quand d’autres les évaluent plutôt dans la mise à l’épreuve du « service rendu aux publics » entendus comme une diversité de communautés (Alain et alii, 2013).
S’agissant de la communauté policière au travail, elle se ressoude et s’unit syndicalement face aux épreuves de l’adversité, qu’elles proviennent des mises en cause du public, des journalistes, des juges et des multiples contrôleurs (Vigouroux, 1996), mais surtout des dangers inhérents au métier. Et ce n’est pas la moindre des ironies de l’histoire de constater que les sous-officiers de la gendarmerie, astreints par tradition militaire à l’interdit du syndicalisme, demandent aujourd’hui en France à voir leur statut aligné sur le régime protecteur des libertés syndicales dont bénéficient leurs homologues policiers.
Science forensique
Publié par BD-SLL
Police métier
Publié par BD-SLL
Article en voie de traduction
There is an endlessly elastic sociopolitical context within which policing operates. This elasticity results in shifting targets, deployment of resources, and new rhetoric that shapes the mandate over time through the stabilizing medium of the police métier. The police métier is a window into the ways in which policing shapes1 the social order in which it is located. This métier contrasts with how policing manages the mandate publicly. Rather, the police métier captures the show occurring backstage, characterized by occupational assumptions and practices focused around and reflexively shaping the incident.
Assumptions are made, as in any occupation, about the politics of the field, the etiquette of treating citizens, mistakes at work, and routines and performances required of the practitioners. This is the assumptive world in which the occupation operates. There is an assumed practical model or logic in action that informs choices made in line with these assumptions. These assumptions and connections are taken for granted as being in the nature of the work and how it is to be carried out. Police practices are verified with reference to the several compatible assumptions that produce them. The assumptions about policing are the context within which practices have a life and a social reality. They reflect the value of the assumptions, and the assumptions are the context within which the practices are lodged. They are mutually supportive and are logical and methodical.
- The police assume they know local areas, people, buildings, places, and their dynamics.
- The structural features of places, neighborhoods, corners, and niches, “pockets of crime,” as St. Jean (2007) terms them, are largely immutable.
- The people found in problematic areas are incorrigible. If they are drug dealers, they are “always dirty” (Moskos 2008, 83) and have no rights because they have forfeited them (ibid., 43–45) and can always be arrested (ibid., 49).
- Long-term “prevention,” “problem solving,” or efforts to change the contours of such neighborhoods have no purchase on shaping policing reality.
- Disorder can be altered superficially by local and personalized “treatments” and pragmatic, order-based policing.
- It is only possible to disrupt, briefly deter, and make the occasional arrest as needed to maintain the essential authority of the officer.
- Policing is differential by targets, time, place, and persons.
- Policing should be personalized in the sense that officers identify with their district or beat.
- While it is democratic in the sense of being responsive, policing in local areas, or neighborhoods, is shaped by ethnicity, class, time of day, and the political context. There is little one can do to change the economy, schools, family life, or religious values; these rarely change.
The Incident Focus
Domestic everyday policing is grounded in what might be called the cynosure of the incident (see Manning 2008, 81–82). Here, the métier is displayed.
In the police world, the incident is a microcosm of sensible, thoughtful, rational individualistic choices. It is the sacred center of policing. The idealized concept of the police officer transcends the actual officer in everyday practice. The officer is idealized as exceptional—he or she stands apart from malice, emotion, prejudice, or distorted perceptions. The sacred status attributed to the officer is complemented in law by the “reasonable man” legal standard. To call actions within an incident sacred is to reaffirm the nature of these social facts — they are obdurate, external, and constraining. Incidents involving corruption, violence, or showing personal everyday flaws such as anger, exultation, or depression are seen as rare by the media and the police and fall under the category of “rotten apples” and exceptions that prove the overall integrity of the police as a body.
The incident is framed or viewed organizationally exclusively as the officer at the scene describes it unless otherwise known. As Moskos writes, “The chain of command is a myth. A sergeant cannot be in active command of five units simultaneously (2008, 112). Moskos captures the “you had to be there” rule: “While an officer may believe that another officer handles certain situations differently, the idea that officers should be allowed to make their own decisions is never in question. If these decisions are wrong, then the officers will face the legal, departmental or physical consequences” (ibid., 112–13). What is left unsaid here, but revealed by the notion of absent supervision, creative writing, management of calls for service, and stops to avoid “trouble,” is the rarity of actual information that might be seen as showing an officer was “wrong” in his or her decisions. “Otherwise known” refers to review later by supervisors, captured by the media or a citizen’s camera, witnessed by third parties with an interest in the outcome, or observed as a result of the officer’s request for advice or backup. Given that the theatrical core of policing is thought to be patrol work, the incident is seen in the context of responsiveness to citizen demand for order and showing activity to supervisors, but it is virtually always a low-visibility matter seen metaphorically through the eyes of the officer.
The Métier’s Sustaining Practices
The first shaping force is the authoritative patterning of relationships called the organization. There is an abiding sense in which the work of the police is structured, that is institutionalized, routinized, unquestioned, done as if there was no other way to do it, taken for granted as to its effectiveness, purposes, and means. These constraints, social facts, make everyday work possible. They are valued up and down the hierarchy of the organization and in that sense are the deep structures that sustain meaning. The basic foundational assumption is that this organizing is functional and rational. The organization is designed to allocate officers to randomly patrol, mostly by automobile, to react and respond to calls, and to investigate “founded” (deemed valid as a result of police investigation of the report) calls. It is so structured and concentrates its resources at the bottom of the organization. The officers focus in the incident from whatever source to which they react. In this sense, “policy” is set on the ground by lower participants’ situated practices. This kind of policy results from decisions made quasi independently and seriatim by loosely supervised officers.
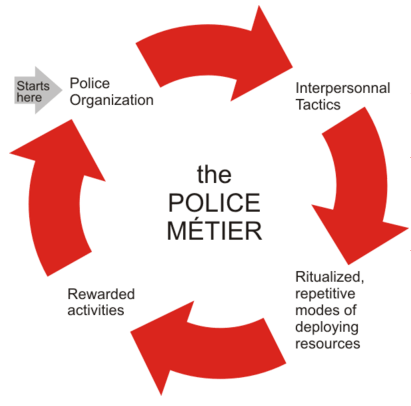
The second shaping force is interpersonal tactics in the incident. The sanctioned interpersonal tactics of policing are those thought to guarantee successful asserting of authority, taking control, closing the incident in some fashion, and returning to service. These are learned on the job from other officers and especially field-training officers, as the academic aspects of their training are viewed as irrelevant and even an impediment to doing good police work (discussed above as “police tactics.”) These constitute an aesthetic from which variation is permitted — a style — that has local departmentally shaped shadings.
The belief is that good policing, or a good piece of police work, has the following features. As a dramaturgical act, it requires:
- sizing up the incident quickly (the police joke is that the officer is supposed to have it sized up before arriving)
- dealing with the current situation in a parsimonious fashion
- avoiding violence or extended arguments
- deciding what to do and how to do it with dispatch
- minimizing paperwork
- producing solutions that facilitate returning to “service” (meaning becoming “available” — patrolling)
- reducing cogitations about eventual guilt or innocence of the parties
- eliminating remedies that are extensive, rehabilitative, educational, or transformative
The belief is that, once framed by the officer and handled in accord with these features, the incident has the social reality attributed to it by the officer. It takes organizational shape as the officer defines and describes it. A protective epigram protects and elevates judgments made on the scene: “You had to be there” (to understand what was done, why it was done, and the results produced). This epigram rules the occupational culture. It protects the officer from criticism or punishment. It has a patently irrational element in that it attributes to officers that which no one possesses: endless patience, insight into human deception, deep penetration into character, a wariness combined with trust, and a moderated “wait-and-see” attitude. Even researchers seek the buried but obvious reasonableness that must characterize police deciding. The idea that “distortions” are called upon suggests that the baseline of police deciding is of course reasonable, and somehow it must be shown by data that emotion, worry, guilt, anxiety, anger, and other mixed feelings exist in police shootings. This epigram and associated stereotype reinforce the inviolate and sacred center of the work — the reasonable, thoughtful, rational, cogitating individual officer, on the street deciding things. It provides for flexibility of action and freedom from close supervision. The officer’s account is virtually the rule of thumb in court as well: if the officer defines him- or herself as being in danger (or a police partner or member of the public), a shooting is considered prudent and legal (Hunt 1985). In addition, since the work is not defined in concrete terms or in terms of the content of the interactions involved, but rather is defined as a social form, what is done is open-ended and can be described using the conventional rhetoric sanctioned within the oral culture.
The third shaping force is repetitive modes of deploying resources. This is partially structural and partially processual — a result of how officers patrol. The repetitive modes of deploying resources (by beats, districts, and other territorially based obligations) ground “order” and ordering in places and doings more than in categories of crime, law, or morality. Policing is about the control of territory and the symbolization of that control. These deployment modes are sensitized by the list (above) of shifting targets, places, and people. In disadvantaged areas especially, where policing is expected as required, policing is played out as reflexive cybernetic policing. It responds to the known understandings of policing about where crime lies, in what areas of the city, and carried out by what groups of people, and during what hours, days, and months of the year. The records kept sustain the validity of the practices because they are based on the same assumptions.
The fourth force is the cluster of rewarded activities. Any organization operates by inducements and their distribution. These inducements to perform policing as expected are based on assumptions about how the social world of work operates, as well as what practices are necessary to cope with this world. These generally revolve around stops, arrests, and other visible interventions in areas known as being full of that potential. As discussed above, the absence of rewards for other activities — problem solving, developing partnerships, working with community groups, excellence in organizational politics (other than rank promotion) — continues to tie the organization to its symbolic crime-control emphasis and ritual attachment to routine stops and “showing activity.”
If we think of the incident as the window in which the practices are displayed, and these in turn being shaped by forces that are social facts, we can see that the incident is a ceremonial locus for repeating that which is valued and recognized as such in policing. In the incident the subjective and objective forces that govern the performance are mobilized. The activities have resemblance, coherence, and not a clear and obvious reality. Yet they are recognizable as “police work” in the here and now. The underlying continuity and resemblance between the actions may not be verbalized or described in nuance; the coherence is often assumed, not directly stated. The terms tied together by a fuzzy logic or like strands in a rope (Wittgenstein 1969) come to mind. They are known in spite of their emergent properties and complexity. These practices, and their existence as known properties of the incident, reproduce the modes of policing so frequently observed.
Notes
1. The term shapes can be only inferred from a number of studies of policing and its impacts as well as the available ethnographies and community studies of those policed.
Références
- Hunt, J. 1985. "Police accounts of normal force." Journal of Contemporary Ethnography 13:315.
- Manning, P.K. 2010. Democratic Policing in a Changing World. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
- _________. 2008. The technology of policing: crime mapping, information technology, and the rationality of crime control. New York: New York University Press.
- Moskos, P. 2008. Cop in the Hood: My Year Policing Baltimore's Eastern District. Princeton: Princeton University Press.
- St. Jean, Pierre 2007. Pockets of crime. Chicago: University of Chicago Press.
- Wittgenstein, L. 1969. The Blue and Brown Books. Oxford: Blackwell.
Policing transnational
Publié par BD-SLL
Le policing peut être défini comme « un ensemble de pratiques qui vise à ordonner les populations humaines qui habitent ou traversent un territoire donné et, simultanément, à garder le contrôle de l’espace et de ceux qui l’occupent » (Sheptycki, 2005: 29) et être ainsi compris comme la somme des mesures visant à assurer l’ordre public et la sécurité des citoyens. Le terme est difficilement traduisible en français, sa traduction littérale de maintien de l’ordre ne recoupant pas complètement ce que sa forme anglo-saxonne suggère. Cette dernière en effet englobe la notion plus générale d’ordre social et considère des acteurs beaucoup plus diversifiés que les seuls représentants des forces de l’ordre au sens étatique du terme (Goldsmith & Sheptycki, 2007).
Policing transnational: approche générale
A l’échelle internationale, on peut constater des dynamiques propres à la mise en place d’un policing transnational. L’utilisation de ce terme désigne l’ensemble des activités entreprises au niveau international afin de lutter contre toutes les formes de criminalité transfrontalière (Bowling & Murphy, 2010). En ce sens, la notion de policing transnational est intimement liée à l’élaboration et à l’usage de la terminologie de criminalité transnationale et par conséquent tend à se justifier comme le contrepoids nécessaire à la montée en puissance de ces entreprises criminelles dépassant les frontières étatiques (Nadelmann, 1993). C’est surtout à la fin des années 1980 et à l’orée des années 1990 que la coopération diplomatique, policière et judiciaire européenne et transatlantique prend toute son ampleur autour de cette question de criminalité transnationale et des moyens à mettre en œuvre pour la contrecarrer. C’est en effet au cours de cette période post- guerre froide que les discours sur la menace militaire s’effacent progressivement (mais pas entièrement) au profit de phénomènes plus diffus, tels que les trafics de stupéfiants, d’êtres humains, d’armes, le blanchiment d’argent, les migrations irrégulières, la corruption ou encore le terrorisme (Bigo, 1996). La coopération comme solution devient le maître mot du policing transnational. Cet impératif découle des discours politiques sur ce qui a été qualifiée de ‘mondialisation de l’(in)sécurité’ comme logique d’amalgame entre ces différentes entreprises criminelles (Bigo, 2003). La communauté internationale, au moyen de réunions, de rencontres, de sommets, ou encore de conventions s’est ainsi munie d’une feuille de route s’articulant autour de l’éducation et de l’échange, de l’entraide juridique, de la facilitation des procédures d’extradition, et du renforcement des capacités d'enquête. Une approche préventive a également été adoptée, visant à réduire les marges de manœuvres des individus ou groupes d’individus perpétrant de tels crimes (Sheptycki, 2000 ; Beare, 2003). Ces orientations se retrouvent dans tous les discours et agendas des institutions internationales qui se sont données comme mission de lutter contre la criminalité transnationale au cours de cette période telles que l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Union Européenne (UE) ou encore le G8.
S’agissant de l’ONU, l’attention grandissante portée à l’internationalisation de groupes criminels a conduit à développer des instruments multilatéraux afin de faciliter les poursuites au niveau international. Dès 1990, l’Assemblée Générale des Nations Unies a opté pour l’adoption de traités modèles d’extradition et d’assistance légale mutuelle dans les affaires criminelles. La Convention des Nations Unies de 1988 sur le trafic de stupéfiants inclut également des dispositions concernant le blanchiment d’argent. La convention onusienne dite de Palerme contre la criminalité transnationale organisée, élaborée en 2000, demeure aujourd’hui le texte de référence de la communauté internationale en la matière.
Au niveau de l’Union Européenne, l’adoption de l’Acte unique en 1987, prévoyant l’abolition des frontières intérieures de la Communauté Européenne et la constitution d’un espace de libre circulation pour les biens et les personnes, a suscité à l’époque de vives réactions de la part de certains professionnels de la sécurité qui redoutaient la création d’une « Europe passoire » aux crimes en tout genre. La nécessité d’accompagner toute ouverture des frontières de mesures corollaires de sécurité a été un discours politiquement efficace dans la préservation de certaines entités professionnelles tels que les douaniers qui appréhendaient la fin de leurs prérogatives. Ainsi, l’espace européen de libre circulation s’est-il accompagné de la mise en place d’instruments de coopération policière et judiciaire au sein des accords de Schengen. L’élaboration d’une politique européenne fondée sur trois piliers distincts en 1999 marquait en outre le développement d’une stratégie dédiée aux enjeux de Justice et Affaires intérieures. Depuis, l’UE n’a cessé de développer et de multiplier les actions et les instruments contre la criminalité transnationale et le terrorisme, et ce jusqu’aux plus récents développements d’une stratégie de sécurité intérieure, adoptée en 2010 dans le cadre du programme de Stockholm. Le G8, quant à lui, a depuis 1995 mis en place de nombreux groupes de travail autour de ces thématiques, rassemblés au sein du Groupe de Lyon/Rome. C’est ainsi que l’on peut parler de la mise en place d’une forme de gouvernance de la sécurité au niveau international.
La préparation, la négociation, la discussion de ces textes érigés en normes internationales sont incarnées par des groupes d’acteurs (qualifiés tour à tour de groupes de travail, de groupes d’experts, de focus group, de comité spécial, etc.), plus ou moins formels et connus, qui méritent une attention toute particulière. La mise en place de ces groupes internationaux dévolus aux questions de sécurité n’est certes pas nouvelle (Anderson, 1995 ; Deflem, 2002). Elle ne constitue pas plus une simple réponse mécanique à des menaces qui seraient ‘nouvelles’ et leur nouveauté supposée demeure un objet de débat en sciences sociales (Bigo, 2003). Néanmoins, la configuration géopolitique post-guerre froide, la publicité donnée aux discours politiques d’amalgame des menaces diffuses et transnationales, ont contribué très certainement à offrir un nouveau souffle et une raison d’être à la multiplication de ces groupes, organismes et autres officines internationaux. Les années 1990 ont vu l’intensification de réseaux professionnels et personnels, tant au niveau européen qu’au niveau transatlantique (Nadelmann, 1993 ; Bigo, 1996). En appuyant et en renforçant l’impératif de coopération autour de ces orientations, les discours politiques ont eu en effet des répercussions considérables sur la définition du rôle et des responsabilités de la police, des magistrats, des services d’investigations, mais aussi de la diplomatie. Depuis lors, policiers, magistrats, diplomates, doivent gérer l’internationalisation du monde, et certains analystes vont jusqu’à parler de l’émergence d’une ‘bureaucratie transnationale’ (Sheptycki 2005).
Parmi ces innombrables groupes d’acteurs, certains ont fait l’objet de travaux de recherche et l’analyse de l’internationalisation des activités de policing a donné lieu à d’heuristiques travaux en criminologie, mais aussi en relations internationales et en science politique. Les premiers pas des services d’Interpol (Deflem 2002), les groupes de travail de l’UE (Anderson, 1995 ; Bigo, 1996), les groupes d’experts du G8 (Scherrer, 2009), l’internationalisation de certains services de police (Andreas & Nadelmann, 2006) ont ainsi fait l’objet de nombreuses études offrant une compréhension plus fine de la genèse et des développements de ces acteurs du policing transnational.
Échanges, collaborations, coopérations
Les activités de ces groupes d’acteurs se sont d’abord concentrées sur les thématiques suivantes : trafic de stupéfiants, d'armes à feu, crimes liés à l’immigration clandestine, corruption. Les moyens d’actions pour contrer et prévenir ces crimes ont surtout été mobilisés dans ces domaines : lutte contre blanchiment d’argent et la falsification des documents d’identité et de transports, l’échange de renseignements, la coopération judiciaire dans les affaires pénales, la mise en place de structures opérationnelles transfrontalières et la promotion de techniques spéciales d’enquête. Plus récemment sont apparus de nouveaux secteurs de prédilection, liés notamment au renouveau de la lutte contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001 et à la diffusion massive des nouvelles technologies (Dupont, 2003) : le financement du terrorisme, la radicalisation, la protection des infrastructures, le cyberterrorisme/cybercriminalité, mais aussi la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet, les fraudes et délits économiques, et enfin les crimes environnementaux.
Les agents chargés de ces questions sont bien souvent des fonctionnaires issus des services de police, de justice, mais aussi de la diplomatie et des finances. Parmi ces groupes d’acteurs du policing transnational, certains sont professionnellement uniformes (réunions de magistrats pour les groupes spécialisés dans les coopérations judiciaires, ou seulement de policiers pour des aspects plus opérationnels), et d’autres font délibérément intervenir différentes compétences et expertises professionnelles, à l’instar du groupe de Lyon/Rome du G8 spécialisé dans les questions de criminalité et de terrorisme (Scherrer, 2009), tout comme le tout récent «Comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure» (COSI) de l’UE qui regroupe à la fois des acteurs des États membres issus de ministères reconnus compétents et des représentants des agences européennes Europol, Eurojust, et Frontex. Les services diplomatiques ont par ailleurs un rôle souvent central dans l’organisation de ces groupes, dans la négociation des réunions, et dans les processus de centralisation des archives. D’ailleurs, la plupart des gouvernements occidentaux se sont munis, au sein de leurs diplomaties respectives, de pôles ou de départements dédiés aux questions de sécurité internationale.
Comme souligné précédemment, ces acteurs du policing transnational travaillent de concert à la facilitation des échanges de savoir-faire (que ce soit en termes d’apprentissage de bonnes pratiques, de knowledge transfer dans les champs d’activité concernés ou de données policières plus confidentielles) et à la mise en place d’accords bilatéraux ou régionaux afin de favoriser, légaliser et d’entériner les formes de coopération et de collaboration.
L’échange de bonnes pratiques et de savoirs constitue un aspect très important de ce policing transnational, créant un fond de références et de normes communes au niveau international. Dans le domaine de la justice, il s’agit surtout d’homogénéisation des procédures d’enquête et de poursuite. La mise en place d’instruments uniformisés est ainsi centrale dans l’adoption de traités d’extradition, ou dans les modalités des enquêtes transfrontalières. Les débats anciens sur le mandat d’arrêt européen ou les débats plus actuels sur la mise en place d’un procureur européen sont autant de signes que le policing transnational adopte des contours de plus en en plus formels, au niveau européen, mais aussi par le biais de traités inter-étatiques ou d’accords de principes négociés lors de ces réunions internationales. Dans le domaine de la police stricto sensu, le policing transnational s’organise autour, là encore, de l’échange des expériences et des savoirs et de la mise en commun de la formation, mais aussi des activités de renseignement. C’est l’UE qui offre à ce niveau les exemples les plus aboutis de ces pratiques. Outre la coopération opérationnelle ponctuelle, notamment au cours d’enquêtes transfrontalières, l’UE a mis en place un Collège Européen de Police, le CEPOL, visant à harmoniser les pratiques policières, mais aussi à éduquer les fonctionnaires de police des États membres à l’harmonisation et à l’européanisation de la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Souvent critiqué pour son absence de visibilité et pour le manque de transparence de son budget, le CEPOL est néanmoins en passe de devenir, avec l’adoption du programme de Stockholm en 2010, un instrument primordial du policing transnational au niveau européen. L’importance croissante de l’intelligence-led policing est également à prendre en compte dans le travail des services de renseignement au niveau international. Ce type de policing, axé sur la prévention des crimes, et notamment des actes terroristes, s’assimile de plus en plus à de la prédiction basée sur le recueil, la centralisation et/ou l’échange de renseignements.
Malgré le caractère moralement contestable de ces mesures, et les inhérentes difficultés juridiques entourant ces notions de prévention/prédiction/préemption, de nombreuses négociations et accords ont été promus et mis en place afin d’organiser ce recueil et ces échanges de données. Au sein de l’UE, cela prend la forme de systèmes d'information formalisés et opérationnels (Système d’Information Schengen – SIS II, Visa Information System – VIS, EURODAC – fichier d’empreintes digitales). Au niveau bilatéral, un exemple qui ne cesse de susciter la polémique, notamment au niveau du Parlement Européen, concerne le transfert aux autorités nord américaines de fichiers des passagers détenus par les compagnies aériennes (Passenger Name Records - PNR), qui a fait l’objet d’accords successifs entre l’UE et les États-Unis, l’Australie et le Canada. L’absence de transparence entourant l’organisation et les bases légales de cet intelligence-led policing au niveau transnational, et la question de l’interopérabilité des systèmes d’information, n’est en effet pas sans créer de tensions, et ce notamment en raison des différentes atteintes aux libertés individuelles que ces pratiques sous-tendent (Scherrer, Guittet & Bigo, 2010). Les débats ont été ainsi nombreux autour des questions de balance entre liberté et sécurité dans la lutte contre le terrorisme, et autour de mise en place de pratiques d’exception pas, peu, ou mal encadrées du point de vue juridique. Le Traité de Lisbonne (2007) et le programme de Stockholm de l’UE (2010) tentent d’ailleurs de rétablir l’équilibre (en séparant les Directions Générales Justice/Affaires Intérieures et en introduisant la codécision dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, offrant un droit de regard plus conséquent du Parlement Européen), sans toutefois rassurer les défenseurs des libertés individuelles, civiles et des droits de l’homme.
Transformations et nouvelles dynamiques
La compréhension et l’analyse du policing transnational constituent des champs d’études ouverts et encore en friches (Goldsmith & Sheptycki, 2007 ; Bowling & Murphy, 2010). Cela tient, en effet, non seulement à la difficulté de recueillir des données sur ceux qui constituent le policing et sur la nature de leurs activités, mais aussi de tenir compte des transformations et reconfigurations permanentes des espaces de production de la sécurité au niveau international. La pluralisation des acteurs, en outre, devient un élément perturbateur du schéma classique de la diplomatie d’État en matière de policing transnational (Scherrer & Dupont, 2010). Si les fonctionnaires étatiques demeurent le plus souvent centraux dans les groupes d’experts évoqués précédemment, l’ouverture à des acteurs privés complexifie considérablement le tableau général. A ce titre, il convient de citer le Groupe de Lyon/Rome du G8, et la mise en place de partenariats publics/privés dans le cadre de la lutte contre le cybercrime. En effet, ce groupe est à l’origine de l’organisation d’une série de conférences et de réunions visant à établir un dialogue et un partenariat entre les industriels et les États. Ces conférences ont parfois réuni plus de trois cents responsables publics et privés. Parmi eux, des représentants des entreprises de télécommunications, des représentants des entreprises de lecteurs de carte à puces, des opérateurs de certification, des courtiers d'assurance pour sites de commerce électronique, mais aussi des agents de compagnies de voyages en ligne. Il est d’ailleurs particulièrement pertinent de souligner que ces conférences ont fait surgir des débats intéressants autour des thèmes de la «co-régulation» dévolue au secteur public et au secteur privé. Il existe d’autres cas de figure donnant à voir une dissociation de l’autorisation de la sécurité et de sa production, notamment dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent (et l’implication des acteurs des secteurs bancaires et de certaines professions libérales), et le financement du terrorisme (avec la participation de fondations privées).
Afin d’analyser la complexité des mécanismes de circulation des savoirs et des pratiques à l’échelle internationale en matière de policing, il existe néanmoins un certain nombre de cadres conceptuels pertinents permettant de s’affranchir d’une lecture simpliste des enjeux. À cet égard, on peut citer les approches en terme de bureaucraties internationales proposées par les tenants de l’analyse criminologique critique (Bowling & Murphy, 2010 ; Deflem, 2002 ; Sheptycki, 2005), les approches sociologiques développées en Relations Internationales autour du concept de champ des professionnels de la sécurité (Bigo, 2007), mais aussi les analyses en termes de gouvernance nodale (Burris, Drahos & Shearing, 2005). Ces différents points de vue ont en commun de réfuter l’argument fonctionnaliste faisant du policing transnational le revers et la réponse à la criminalité transnationale. Ils offrent des perspectives pour analyser les phénomènes de mobilité de ces acteurs qui voyagent d’un groupe à un autre, d’un continent à l’autre, pour les recenser et les cartographier en tenant compte de leur diversité, positionnements, compétences et ressources mobilisées, mais aussi afin de comprendre leur impact non seulement sur la diffusion de normes et de pratiques anti-criminalité sur la scène internationale mais aussi sur les pratiques de policing au niveau national.
Références
- Anderson M. et al. (1995). Policing the European Union. Oxford: Clarendon Press.
- Andreas, P. Et Nadelmann E. (2006). Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations. Oxford: Oxford University Press.
- Beare, M. (2003). Critical reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering and Corruption, Toronto: Toronto University Press
- Bigo, D. (1996). Polices en réseaux, l’expérience européenne. Paris : Presses de Sciences Po.
- Bigo, D. (2003). Grands débats dans un petit monde : les débats en Relations Internationales et leur lien avec la sécurité. Cultures & Conflits 19-20 : 7-48.
- Bigo, D. (Ed.) (2007). The Field of EU Internal Security Agencies. Paris: Harmattan
- Bowling, B., Murphy, C. (2010). Global Policing. London: Sage.
- Burris, Scott, Drahos, Peter, Shearing, Clifford (2005). Nodal Governance. Australian Journal of Legal Philosophy 30: 30-58.
- Deflem, M. (2002). Policing World Society. Historical Foundations of International Police Cooperation. Oxford: Oxford University Press.
- Dupont, B. (2003). Les morphologies de la sécurité après le 11 septembre : hiérarchies, marché et réseaux. Criminologie 38(2) : 123-155.
- Goldsmith, A. and Sheptycki, J. (2007) Crafting Transnational Policing; State-Building and Global Policing Reform, Oxford: Hart Law Publishers
- Nadelmann, E. A. (1993) Cops Across Borders. The Internationalization of US Law Enforcement University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- Scherrer A. (2009). G8 against Transnational Organised Crime. Farnham : Ashgate
- Scherrer A., Dupont, B. (2010). Nœuds ou champs ? Analyse de l'expertise internationale sur la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Revue Canadienne de Criminologie et de Justice Pénale, 52, 2 : 147-172
- Scherrer A., Guittet E-P., Bigo, D. (2010). Mobilités sous surveillance. Perspectives croisées UE/Canada. Montréal : Athéna.
- Sheptycki, J. (2005). En quête de police transnationale. Vers une sociologie de la surveillance à l’ère de la globalisation. Bruxelles : De Boeck & Larcier
- Sheptycki, J. (ed.). (2000). Issues in Transnational Policing. London: Routledge.
Formation policière
Publié par BD-SLL
À l’heure de la professionnalisation de la fonction policière en Occident, la question de l’adéquation du continuum de formation avec cette fonction se pose plus que jamais. Il est clair que les enjeux d’une complexification croissante de ce que l’on attend de la police remettent en cause l’idée même d’un continuum de formation essentiellement orienté en fonction des connaissances techniques du métier, la question n’étant plus de savoir jusqu’à quel point une formation d’un tel ordre est maintenant dépassée, mais bien de positionner adéquatement les dispositifs de formation pour répondre à ces modifications fondamentales.
À cet égard, on peut distinguer essentiellement deux grands types de modèles de formation, selon qu’ils sont, comme en France par exemple, très centralisés ou qu’ils sont, comme c’est notamment le cas aux États-Unis, extrêmement disparates et décentralisés. On pourrait alors comprendre qu’entre ces deux pôles se retrouveront des modalités de formation au diapason des modalités de déploiement des forces policières elles-mêmes. Ainsi, si la France présente une modalité de déploiement centralisée et uniforme, la formation de base donnée aux policiers l’est donc d’autant, tandis qu’à l’inverse, dans un pays marqué par un très grand nombre d’organisations policières très différentes les unes des autres comme c’est le cas aux États-Unis et en Italie, il demeure logique d’y retrouver des modalités de formation policière toutes aussi différentes d’un endroit à un autre.
Le cas de la formation policière en Allemagne pourrait ainsi être présenté comme relevant d’une situation un peu mitoyenne. En effet, il revient à chacun des Länder de pourvoir leur propre faculté universitaire technique qui, au terme d’une formation de trois ans, diplômeront les officiers de police ensuite engagés dans le service policier du Land :
« L’insistance mise à doter l’encadrement policier d’une formation solide appuyée sur des bases scientifiques, visait à réduire la clôture traditionnelle de l’institution sur elle-même et à lui donner les moyens de s’adapter de façon souple dans une période de changements socio-culturels extrêmement rapides. Cet objectif a d’ailleurs été atteint, dans la mesure où la formation de l’encadrement intermédiaire dans les écoles professionnelles supérieures et l’intégration dans les enseignements d’un large éventail de connaissances scientifiques en provenance de disciplines aussi diverses que le droit, la psychologie, la criminologie et la sociologie a donné à de nombreux policiers une ouverture d’esprit et une compréhension des phénomènes sociaux qui manquaient aux générations précédentes. » Funk et Reinke, 1992 : 54.
Pour les officiers qui, au terme des divers concours, accéderont au service de police fédéral, une mise à niveau leur sera donnée au sein d’une faculté universitaire elle aussi, de niveau fédéral. Or, toujours dans le cas de l’Allemagne, il est notoire que la réunification avec l’ex Allemagne de l’est n’a pas été sans remettre quelque peu en question l’uniformité du continuum de formation (Funk et Reinke, 1992): ces Länder ont du rapidement instaurer leur propre faculté universitaire technique qui n’ont en fait d’universitaire que le nom, celles-ci étant généralement des anciennes académies militaires, et où on a tout simplement changé l’uniforme des instructeurs. Les policiers formés dans ce contexte se retrouvent en situation de carence de connaissances et de compétences lorsqu’ils parviennent au niveau fédéral, la faculté ayant alors du concevoir toute une série de mises à niveau destinées aux recrues provenant des Länder de la partie anciennement communiste du pays. Outre la question de ces disparités, le modèle de formation policière allemand demeure également relativement dispendieux; en effet, les futurs officiers de police devront, avant d’être admis à la faculté, occuper une fonction subalterne au sein des polices des Länder pendant quelques années. Une fois admis à la faculté, les recrues conserveront leur salaire de cadet pendant les trois années de formation; ce n’est qu’une fois passé les concours d’admission comme officier, à un âge significativement plus élevé que dans le cas des policiers d’Amérique du nord, par exemple, que leur condition salariale rejoindra celles de leurs collègues de pays comparables.
Le cas de l’Allemagne, tout comme celui de plusieurs pays scandinaves, pose tout entier la question de la pertinence d’une formation de niveau universitaire et de son adéquation avec les défis contemporains qui se posent à la police : s’agit-il de la voie royale à emprunter? La question s’est posée et se pose encore d’ailleurs au Québec, où plusieurs mandats ont été confiés au cours des dernières années afin de vérifier la pertinence de hausser le calibre de la formation qui y est donnée pour les futurs policiers et les policiers en devoir. Ainsi, on retrouvera des recommandations en ce sens tant dans le rapport Bellemare (1996), que le rapport Corbo (1997) et que le rapport de la Commission Poitras (1998), portant plus spécifiquement dans ce cas ci à une seule institution policière, soit la Sûreté du Québec. Jusqu’à un certain point, on pourra reconnaître qu’il s’agit là d’une question plus typique des systèmes de police qui ne recourent pas aux entrées latérales et où l’accession aux fonctions supérieures se fait presque exclusivement par voie d’ancienneté. En effet, et ici on peut spontanément penser au cas de la France, on pourra très bien exiger un diplôme universitaire pour les fonctions dites supérieures – celle de commissaire divisionnaire, par exemple – étant entendu que les concours d’accès sont ouverts sur la base de cette exigence précise et non de celle d’une expérience préalable de la fonction policière, comme c’est plus généralement le cas en Amérique du nord.
Pour en revenir au cas du Québec, la base de la formation y est assez similaire à celle que l’on retrouve dans la plupart des pays occidentaux et mis à part les cas de l’Allemagne et des pays scandinaves dont nous avons fait état, soit l’équivalent d’un diplôme technique collégial. À l’heure actuelle, ce sont 12 institutions collégiales (11 francophones et 1 anglophone) qui dispensent les cours de la formation de base en technique policière :
« Le contenu des programme est conçu selon l’approche par compétences, qui vise à développer les aptitudes des étudiants à s’acquitter des tâches spécifiques au travail policier. Les méthodes pédagogiques mobilisées font appel à des mises en action concrètes (simulations, reconstitutions et études de cas) et à des liens avec le monde de la pratique (stages et bénévolat) Ces cours techniques sont complétés par des cours plus théoriques de criminologie, de sociologie, de psychologie, de droit et de littérature, destinés à sensibiliser les étudiants à la diversité de la société québécoise, à l’importance de l’intervention auprès des victimes, aux diverses formes de criminalité, aux techniques de prévention et de résolution de problèmes, ainsi qu’aux pouvoirs et aux devoirs légaux attachés à la fonction policière. » Dupont et Pérez, 2006 : 68.
Les 12 institutions réparties à travers le Québec vont former environ 950 diplômés par année. Et ce sont entre 650 et 700 de ces 950 diplômés qui accéderont au stade final de la formation qualifiante de base qui est donné, dans ce cas, en exclusivité en un seul endroit, soit à l’École nationale de police du Québec (ENPQ).
Mais avant de détailler davantage cette dernière étape de la formation qualifiante initiale des patrouilleurs en uniforme, il convient de souligner qu’au Québec et au contraire de plusieurs autres endroits ailleurs dans le monde, la profession policière est extrêmement populaire et recherchée : on y fait de bons salaires, les taux de placement au terme de la formation de base atteignent près de cent pour cent et on peut prétendre à la retraite après 25 ans de service, soit à un âge où une seconde carrière est tout à fait envisageable, ce qui ouvre la possibilité de cumuler un nouveau salaire et une rente de retraite déjà fort généreuse. Il est dès lors peu surprenant de constater qu’à l’entrée du cursus, quatre demandes sur cinq sont rejetées et que seulement un candidat sur vingt parviendra à décrocher le diplôme [1].
Si l’on peut penser que ce niveau élevé de compétition garantira que seuls les meilleurs candidats et candidates passeront au travers du processus, on pourra également penser qu’en revanche, il se créera un niveau d’attente tout aussi élevé (Alain et Grégoire, 2008; Alain et Baril, 2005a, 2005b). Or, compte tenu du fait que la structure de fonctionnement de l’organisation policière est composée à près de 75% de policiers qui demeureront tout au long de leur carrière aux premiers niveaux hiérarchiques, des déceptions sont d’autant plus susceptibles de marquer les premiers pas de nos recrues, à qui on a jamais manqué de rappeler, tout au long de leur formation, à quel point ils constituent une élite, aspirant donc ainsi aux plus hautes fonctions de la hiérarchie (Alain, 2010). Notons qu’un tel phénomène n’est pas exclusif au Québec (il a été fort bien documenté en Australie par Chan, 2003) et on le retrouve également dans d’autres professions où l’accès à la formation qualifiante est très contingenté (Dubar, 2000; Dubar et Tripier, 2003).
Pour en revenir à la formation donnée par l’ENPQ, et comme la plupart des organisations policières s’attendent à ce que les recrues performent au plus haut niveau possible dès leur embauche [2], les éléments abordés pendant le stage de 15 semaines s’enchaînent les uns aux autres à un rythme rarement observé dans la réalité. En fait, le programme développé à l’ENPQ tente de résoudre le dilemme créé par la nécessité de donner aux candidats le maximum de compétences en un court laps de temps, tout en maintenant un certain réalisme au niveau des situations simulées qui sont offertes aux apprenants. On pourra comprendre que ce dilemme explique en partie le fait que plusieurs recrues se disent déçues par certains aspects plus répétitifs et routiniers de la fonction policière (Alain et Baril, 2005).
Il existe, pour clore ce court article, toute une série de modalités de formation continue en emploi, destinée exclusivement ou non, aux policiers en exercice. En effet, et ce depuis l’instauration de la toute dernière mouture de la Loi sur la police en 2000, on exige une formation qualifiante additionnelle pour tout policier aspirant à passer au domaine des enquêtes et éventuellement aussi à celui de la gestion/direction. Dans ces deux cas, il s’agit de formations qui, données en alternance travail-études, sont sanctionnées par un diplôme universitaire. Les contenus des cours sont partagés par plusieurs universités québécoises, selon leur localisation géographique et leurs champs de spécialisation. Finalement, on pourra clore ce portrait en évoquant l’existence d’une pléthore de formations pointues, offertes par le secteur privé, voire par les plus grosses organisations policières elles-mêmes, et destinées à la mise à jour des compétences techniques nécessaires aux opérations de maintien de l’ordre et des enquêtes spécialisées.
Références :
- Alain M., Baril C., 2005a, Attitudes et prédispositions d’un échantillon de recrues policières québécoises à l’égard de leur rôle, de la fonction policière et des modalités de contrôle de la criminalité, Les Cahiers de la sécurité, 58, 185-212.
- Alain M., Baril C., 2005b, Crime Prevention, Crime Repression, and Policing: Attitudes of Police Recruits Towards Their Role in Crime Control, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 29, 2, 1-26.
- Alain, M. & Grégoire, M. (2008) Can ethics survive the shock of the job? Quebec’s police recruits confront reality. Policing & society, 18(2) : 169-189.
- Alain, M. (soumis, 2010). Les processus d’insertion professionnelle d’un échantillon de recrues policières québécoises : bilan d’une enquête longitudinale de six ans. Article soumis à la revue la revue Déviance et Société.
- Bellemare, J., 1996, Les pratiques policières en matière d’enquêtes criminelles au sein des corps de police du Québec, Sainte-Foy, Publications du Québec.
- Chan J., 2003, Fair cop: learning the art of policing, Toronto, University of Toronto Press.
- Corbo, C. (1997). Vers un système intégré de formation policière. Ministère de la Sécurité publique, Sainte-Foy.
- Dubar C., 2000, La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, Paris, A. Colin.
- Dubar C., Tripier P., 2003, Sociologie des professions, Paris, Armand Colin.
- Dupont, B. et Pérez, É. (2006). Les polices au Québec. Presses Universitaires de France, Paris.
- Funk, A. et Reinke, H. (1992). La police en République Fédérale d’Allemagne, in Polices d’Europe (coll.). L’Harmattan, Paris.
- Poitras, L., 1998, Pour une police au service de l’intégrité et de la justice, Sainte-Foy, Publications du Québec.
[1] Un des effets notable de ce contingentement est d’avoir considérablement gonflé de policières les rangs de cette profession traditionnellement masculine. Comme on sait qu’en général les jeunes femmes sont nettement plus assidues aux études que leurs confrères masculins, elles affichent des rendements scolaires qui leur ouvrent plus facilement la porte des programmes contingentés. Ce qui fait donc que sans même s’être dotées de politiques officielles de discrimination positive, les organisations policières québécoises ont vu leur rangs être occupés par près de 40 pour cent de policières au cours des quelques dernières années.
[2] Il est important de souligner ici qu’au contraire de la plupart des « académies » de police en Amérique où les étudiants ont déjà été recrutés par une organisation policière, organisation qui en conséquence défraie une salaire de base et les coûts liés à ce stage final, les futurs policiers québécois ne vont être formellement engagés qu’au terme des 15 semaines de stage. Bien sûr, c’est ce futur policier qui assume alors une partie substantielle des coûts associés à son passage à l’ENPQ et il n’est pas non plus inscrit sur la liste de paie d’une organisation policière.
Profilage racial
Publié par BD-SLL
On appelle « profilage racial » (ethnic profiling) l’emploi de généralisations fondées sur l’ethnie, la race, la religion ou l’origine nationale supposées plutôt que sur des preuves matérielles ou le comportement individuel pour fonder la décision de contrôler l’identité d’une personne ou d’engager des poursuites, et plus généralement pour toute activité de contrôle, de surveillance ou d'investigation. L’expression « profilage » vient de la diffusion dans le langage courant de techniques propres à l’analyse criminelle, qui vise à repérer des profils atypiques ou singuliers depuis des bases de données individuelles en vue d’orienter les enquêtes. Le président américain Bill Clinton a naturalisé l’emploi du terme en déclarant que « le profilage racial est tout le contraire d’une bonne pratique de police, laquelle repose sur des faits établis et non sur des stéréotypes. Le profilage est une mauvaise méthode, il est destructeur et il doit cesser » (cité in Melchers 2003, p. 359). L’expression s’apparente en France à celle de discriminations à raison de la couleur de peau, de l’apparence physique, de l’origine nationale supposée.
Aujourd’hui, les travaux, tant qualitatifs que quantitatifs, sur ces questions sont depuis la commission Kerner innombrables aux États-Unis (Rice & White 2010). Ils ont été plus tardifs en Grande-Bretagne, dans le sillage de la commission de Lord Scarman, au début des années 1980 (Rowe 2007). Ils sont beaucoup plus récents et sporadiques en France ou au Canada (Tremblay 1999, Jobard 2007). L’essentiel des recherches porte sur la question de l’objectivation même du profilage.
C’est que l’objectivation des pratiques bute sur un problème considérable, qu’illustre par exemple le débat autour de l’affirmation par le Toronto Star en 2002 que les policiers de Toronto pratiquent le profilage. Les journalistes ont montré sur la base de documents policiers que les Noirs représentaient 33% des personnes stoppées au cours d’opérations de contrôle routier, alors qu’ils ne constituent que 8% des habitants de la ville. De même, 24% des personnes arrêtées pour simple détention de drogue étaient des Noirs. Les écarts étaient suffisamment amples pour constituer des cas de profilage.
Cette publication, contre laquelle la police engagea des actions en justice, butait sur le problème majeur en matière de profilage : le dénominateur. La difficulté est en effet double en matière d’objectivation quantitative : quelles données relatives aux populations visées collecter? à quelle population de référence les comparer?
Concernant les données pertinentes, on accepte dans certains pays (essentiellement les pays de common law) de collecter des données à caractère « racial » ou « ethnique » et/ou l’on dispose de dossiers de police faisant état de l’identification raciale des personnes contrôlées ou arrêtées. Plane néanmoins sur ces documents le soupçon qu’ils ne mentionnent pas toutes les personnes contrôlées, mais seulement celles pour lesquelles les policiers pouvaient invoquer une raison légitime de contrôle. Dans tous les autres pays, c’est au chercheur de construire ses propres outils d’objectivation ; soit à partir d’observations standardisées, soit à partir de reconstructions fondées sur les noms et/ou les lieux de naissance, ou encore les photographies tirées des fichiers policiers.
Le problème de la population de référence est quant à lui le même dans les deux systèmes. Le recensement national avec identifiants ethniques des individus est en la matière d’un maigre secours. La population d’une ville ou d’un pays n’est en effet pas la population de référence pertinente. Dans le cas des contrôles routiers, la population pertinente est celle des automobilistes empruntant les voies contrôlées aux moment des contrôles ; et cette population n’est pas celle des habitants recensés (qui n’est pas plus celle des individus se promenant dans les aires d’échange de drogue aux horaires des transactions en question). L’équipe de Peter Waddington a comparé dans deux villes anglaises les données policières concernant les personnes contrôlées et la composition raciale des villes sur la base du recensement (Waddington 2004). L’écart était substantiel. Mais ils ont ensuite mesuré la composition de la population « disponible au contrôle » (available population), en observant de manière systématique les aires contrôlées aux heures de contrôle, et en doublant ces observations du codage des images tirées des caméras de vidéosurveillance. Cette fois, il n’y a plus d’écart entre population contrôlée et population disponible. Ron Melchers, dans sa critique de l’enquête du Toronto Star, estimait que tenir la population recensée pour la population de référence constitue la « pire méthode » possible… (Melchers 2003).
Dans une recherche que nous avons menée à Paris en 2007-08 (Open Society, 2006; Lévy & Jobard 2010), nous avions dû déployer des moyens particulièrement coûteux pour constituer la population de référence : poster des observateurs à tous les points d’entrée des lieux enquêtés et relever les caractéristiques des personnes entrantes sur ces lieux. Environ 37.000 personnes ont été ainsi codées, qui comparées aux 525 contrôles d’identité que nous avions collectés (à l’insu des policiers qui les pratiquaient), témoignaient d’un écart substantiel entre population disponible et population contrôlée ; cette dernière étant bien plus masculine, jeune, habillée de manière typiquement jeune et relevant de minorités visibles, que la population disponible, et ce tant sur les lieux avec faible présence de minorités que sur les lieux avec forte présence de minorités. Nos résultats tranchaient avec ceux de Waddington, et étaient plutôt comparables à ceux observés dans le métro de Moscou quelques années plus tôt sur la base d’une méthode identique (Open Society 2006).
Le problème du dénominateur, ou de la population de référence, n’est pas un simple problème méthodologique : la population de référence constituée par le chercheur porte en elle une représentation implicite du mandat de la police. Le mandat de la police peut être celui de ne pas profiler. Le mandat de la police peut être, au contraire, de cibler des populations tenues pour dangereuses ou délinquantes. Si l’on retient cette dernière perspective, il faut constituer une population de référence reflet de la population de délinquants ou fauteurs de trouble. Dans le cadre du contrôle routier, par exemple, cette population de référence doit être représentative de ceux qui commettent des excès de vitesse ou dont le véhicule présente des défauts visibles, et non pas des automobilistes en général. L’Américain John Lamberth s’est livré sur les autoroutes du Maryland et du New Jersey à cet exercice (uniquement sur les excès de vitesse) en faisant rouler son véhicule à la vitesse maximale autorisée sur le tronçon sur lequel sévissaient des policiers et en notant les caractéristiques des automobilistes qui les doublaient. Lamberth a montré que l’écart constaté entre population stoppée et échantillon d’automobilistes reste significatif lorsque l’on substitue l’échantillon d’auteurs d’excès de vitesse (violators’ benchmark) à l’échantillon d’automobilistes (Kadane, Lamberth 2009). D’autres auteurs ont cherché à affiner la population de référence dans le cas de contrôles de piétons. Ridgeway et MacDonald (2009) ont montré que 53% des piétons contrôlés à New York sont des Noirs, alors mêmes que ceux-ci ne constituent que 24% de la population de la ville. Mais en constituant pour population de référence la population constituée par les auteurs d’infraction (y compris non élucidées : population de référence = interpellés + suspects), l’écart s’inverse en ce qui concerne les Noirs, dont la proportion est moindre dans la population contrôlée que dans la population délinquante. On peut aussi estimer que la police a historiquement pour fonction la protection des populations dominantes (racial threat theory). Dans ce cas, c’est moins la population de référence qui est en jeu que la composition du quartier dans lequel les policiers patrouillent. On a ainsi pu mesurer, aux États-Unis, que les Noirs sont sur-contrôlés dans les quartiers à majorité blanche, mais qu’ils ne l’étaient pas dans les quartiers où les Blancs sont en minorité ; comme si l’enjeu des contrôles, conformément à la racial threat theory, est bien de surveiller l’intrus, le stranger plus que le foreigner. Ce profilage peut ne pas jouer, ou alors de manière très tempérée, dans les décisions d’interpeller lors du constat d’un délit flagrant : l’équipe de Pierre Tremblay avait noté que les décisions des policiers sont plus sévères dans les quartiers noirs de Montréal que dans les quartiers blancs, mais cette sévérité est plus forte pour les Noirs et pour les Blancs (Tremblay 1999).
La boîte des problèmes méthodologiques n’est par ailleurs pas définitivement refermée lorsque le problème du dénominateur est réglé. Reste le problème classique dans le domaine de la discrimination des effets de composition, problème que l’on rapprochera de la notion juridique de discrimination indirecte, à l’œuvre dans l’Union européenne, ou de la notion politique de racisme institutionnel, développée en Grande-Bretagne (Rowe 2007). Lorsque l’on constate que des minorités visibles sont sur-contrôlées au regard de la population disponible, il faut s’assurer que cet écart n’est pas imputable à un effet de construction des variables : si l’on ne définit les individus que par la variable ethnique, on a toutes les chances de la voir jouer un rôle important. Dans la recherche sur Paris, nous avions ainsi introduit une variable « sac porté » (compte tenu de l’importance des dispositifs anti-terroristes) et une variable «tenue vestimentaire» (compte tenu de l’importance aux yeux des policiers des vêtements comme signaux d’appartenance à des groupes pertinents, les diverses tenues hip-hop étant ici primordiales). Et, au final, s’il n’est pas déraisonnable de formuler un diagnostic de profilage, il reste très difficile de distinguer la part respective des variables âge, race, tenue, genre, puisque la plupart des personnes contrôlées sont des jeunes hommes sans sac issus de minorités visibles habillés hip-hop… et que dans la population disponible, deux tiers des personnes habillées hip-hop relèvent de minorités visibles. D’un point de vue méthodologique, il est nécessaire de disposer d’un grand volume de contrôles d’identité pour effectuer les calculs permettant d’isoler les effets propres de chacune des variables (la même remarque vaut, incidemment, pour les prétendues sciences actuarielles visant l’établissement de profils types de tueurs en série ou de prédateurs sexuels).
Ce souci n’est pas seulement méthodologique, mais soulève la question politique (ou juridique) des effets incidents, éventuellement non désirés, des doctrines policières : si l’on enjoint à la police parisienne (ou aux polices américaines) de renforcer les contrôles visant les jeunes fauteurs de trouble des cités de banlieue, supposés habillés hip-hop (ou de déclarer la « guerre à la drogue »), on accroîtra les chances de voir la police à Paris se concentrer principalement sur les Noirs et les Maghrébins (ou les polices américaines sur les Noirs). L’établissement de profils non raciaux peut susciter le sur-contrôle des minorités visibles. Notons que l’établissement de critères absolument libres de tout biais racial est particulièrement difficile dans un domaine où (à la différence des politiques scolaires ou d’emploi, par exemple) le travail de la police est sur la voie publique principalement un travail fondé sur le décryptage des apparences, sur une sémiologie (Brodeur 2003).
Le contrôle n’est pas la seule modalité d’expression du profilage : toute décision policière est susceptible de révéler des biais de sélection au préjudice d’un groupe ou l’autre, même si l’expression de « profilage » incite à se concentrer sur les mécanismes de sélection à ciel ouvert (dans un océan de données ou de piétons) plutôt que sur des mécanismes décisionnels dans des procédures judiciaires (par exemple : placer en garde à vue). Les recherches nord-américaines sur le « comportement des agents chargés de l’application de la loi » (selon l’expression de Donald Black « behavior of law ») sont là considérables. Dans l’espace francophone, ces recherches ont été plus rares. On a relevé la recherche de Pierre Tremblay sur l’écologie des arrestations policières. On notera, en France, l’émergence de cette problématique à la fin des années 1970, puis après un long répit au milieu des années 2000. La thèse de M.-C. Desdevises portant sur l’examen de 153 dossiers judiciaires à Nantes suggérait que « le groupe algérien fait beaucoup plus souvent l'objet de mesures de détention provisoire, sans que cette différence de traitement tienne aux caractéristiques de sa délinquance ou de sa situation sociale » (in CFERS 1980, p. 81). Une enquête dirigée par Annina Lahalle (in CFERS1980) portant sur 386 dossiers de mineurs délinquants sur lesquels les policiers ou les gendarmes étaient amenés à formuler des appréciations de personnalité (parmi lesquels 36,5% de mineurs maghrébins) montrait que "la police a une attitude nettement plus répressive que les travailleurs sociaux quand il s'agit de mineurs maghrébins", et qu’elle ne recommandait notamment presque jamais de mesure éducative. La thèse de René Lévy concluait quant à elle, sur la base d’une analyse multivariée, que « Dans sa composition ethnique, la population déférée n’est pas identique à la population mise en cause par la police. Et de même, cette dernière se distingue de ce point de vue de la population d’ensemble au sein de laquelle elle est prélevée. La cause de ces différences réside dans les pratiques policières sélectives qui sont mises en œuvre tant au stade de la prise en charge des affaires et des personnes, qu’au stade des décisions cruciales prises ultérieurement » (Lévy 1987, p. 145).
Au milieu des années 2000, la préoccupation quantitative pour ces questions a de nouveau émergé avec la recherche de Lévy et Jobard sur les contrôles d’identité, et celle de Jobard et Névanen (2007) sur les discriminations judiciaires qui montrait que toutes choses égales par ailleurs les policiers étaient plus susceptibles de se constituer partie civile (et ainsi favoriser le prononcé d’une peine plus sévère) contre les Maghrébins ou les Noirs lorsqu’ils sont victimes d’agression physique ou verbale (Jobard 2009). Dominique Duprez et Michel Pinel ont, quant à eux, montré le caractère plus sélectif des épreuves subies par les candidats maghrébins (surtout hommes) au métier de policier (Duprez et Pinet, 2001).
Quoiqu’il en soit, le profilage ou, pour le dire plus largement, les pratiques différenciées des policiers selon les groupes, est un élément majeur de la crise de légitimité des polices auprès des minorités. Les enquêtes menées aux Etats-Unis montrent que les minorités restent convaincues de la prévalence élevée des pratiques de profilage, même lorsque les individus interrogés déclarent ne pas avoir été eux-mêmes contrôlés ni avoir subi quelque mesure de police. La force des expériences vécues ou des expériences rapportées par des proches pèse sur les jugements exprimés, qui obèrent à leur tour des chances de réussite des politiques mises en place pour lutter contre ce phénomène estimé à partir des années 1980 dans les pays de common law comme très corrosif pour l’action des forces de police. L’histoire de longue durée de la relation entre policiers et minorités est telle que si un Noir se voit contrôlé, alors même que les contrôles se révèlent être effectués sur une base parfaitement aléatoire ou représentative de la population disponible, le récit qu’il sera susceptible d’en faire insistera sur le fait qu’il aura été contrôlé en tant que Noir– et comment pourrait-il en être autrement dès lors qu’il n’a aucun moyen de vérifier que l’ensemble des contrôles effectués ce jour-là n’ont pas été discriminatoires ? Son récit relancera alors auprès de ses proches la conviction selon laquelle le profilage reste une pratique fondamentale de la police. C’est en ce double sens que la police joue avec les apparences : son travail repose sur une sémiologie particulière de l’espace public, mais ce qu’elle donne à voir est une pièce maîtresse de sa légitimité. Les politiques visant à limiter les pratiques de profilage, outre qu’elles se déploient dans un espace où la loi, généralement, entretient un flou certain sur ce qu’il autorisé de faire, butent sur le legs de la police et ses relations historiques avec les minorités.
Septembre 2010
Références
- Brodeur, J.-P., 2003, Policer l’apparence, in Les visages de la police. Pratiques et perceptions. Montréal : PUM.
- CFRES, 1980, Les jeunes immigrés. Eux et nous. Vaucresson : CFRES, p. 65-86.
- Duprez, D., Pinet, M., 2001, La tradition, un frein à l’intégration. Le cas de la police française, Cahiers de la sécurité intérieure, 45, p. 111-138.
- Jobard, F. 2009, Police, justice et discriminations raciales, in D. Fassin, E. Fassin (dir.), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française. Paris : La Découverte, 2e éd.
- Jobard, F., 2010, Gibier de police. Immuable ou changeant ?, Archives de politique criminelle.
- Kadane J.B., Lamberth J., 2009, Are blacks egregious speeding violators at extraordinary rates in New Jersey ? , Law, Probability and Risk, 8, 139-152.
- Lévy, R., 1987, Du suspect au coupable. Le travail de police judiciaire, Paris/Genève, Klinksieck/Médecine et hygiène.
- Lévy, R. & Jobard, F., 2010. Les contrôles d'identité à Paris. Questions pénales, 23(1).
- Melchers R., 2003, Do Toronto Police engage in “racial profiling”?, Revue canadienne de criminologie et de justice pénale , 45(3).
- Open Society Justice In Initiative, 2006, Ethnic profiling in the Moscow Metro, New York, Open Society Institute.
- Rice St., White M. (dir.), 2010, Race, Ethnicity, and Policing. New and Essential Readings. New York: New York University Press.
- Ridgeway G., Macdonald J.M., 2009, Doubly Robust Internal Benchmarking And False Discovery Rates For Detecting Racial Bias In Police Stops, Journal Of The American Statistical Association, 104, 486, 661-667.
- Rowe, M. (dir.), 2007. Policing Beyond Macpherson: Issues in Policing, Race And Society, Cullompton: Willan.
- Tremblay, P., Tremblay, M. & Léonard, L., 1999. Arrestations, discriminations raciales et relations intergroupes. Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, 457-478.
- Waddington, P.A.J., Stenson, K. & Don, D., 2004. In Proportion Race, and Police Stop and Search, British Journal of Criminology, 44(6), 889-914.
Violences urbaines
Publié par BD-SLL
L’expression « violence(s) urbaine(s) », aujourd’hui très répandue en France, doit sans doute une partie de son succès à son absence de rigueur, c’est-à-dire son absence de définition. Le mot « violence » est en effet extrêmement général, et l’adjectif « urbaine » n’ajoute rien de plus précis (le contraire serait « violence rurale » ?). En pratique, l’expression semble surtout désigner tout ou partie des formes de désordres, de révoltes et de délinquances que l’on attribue aux « jeunes des cités », autre catégorie aux contours vagues. Les enjeux que signalent l’apparition et la banalisation de cette expression dans le débat public s’éclairent cependant lorsque l’on interroge son origine et que l’on découvre qu’il ne s’agit pas d’une catégorie sociologique mais policière, qui s’est progressivement imposée dans les discours politiques et médiatiques. Il faut donc la déconstruire, avant de revenir à l’analyse des phénomènes qu’elle amalgame.
C’est au début des années 1990 que l’expression « violence(s) urbaine(s) », apparaît dans certains discours policier sur la délinquance juvénile, sur les émeutes et sur les quartiers populaires et leur population parfois majoritairement « issue de l’immigration ». Le déclencheur semble être la série d’émeutes qui surviennent en banlieue lyonnaise en octobre 1990 puis entre mars et juillet 1991 dans la banlieue parisienne [voir l’entrée « Émeutes en France »]. Ces émeutes ont un grand retentissement et provoquent une réelle inquiétude dans le débat public, dans la classe politique et la haute administration (Rey, 1996). Une partie de la hiérarchie policière décide alors apparemment de promouvoir auprès des élus et des journalistes sa propre vision des choses. L’organe clef de cette opération fut le Syndicat des commissaires et des hauts fonctionnaires de la police nationale (SCHFPN), alors en situation de quasi monopole syndical au sommet de la hiérarchie policière. Ses représentants se lancent dans une entreprise de communication inédite, publiant régulièrement des communiqués de presse, donnant de nombreuses interviews, s’exprimant à des colloques, publiant des articles dans des revues « grand public » ou para-universitaires, publiant des ouvrages chez des éditeurs parfois de type universitaire. C’est le cas par exemple du commissaire divisionnaire Bousquet, administrateur du SCHFPN, dans des ouvrages intitulés Insécurité : nouveaux risques. Les quartiers de tous les dangers (1998) et Insécurité : nouveaux enjeux. L’expertise et les propositions policières (1999). La stratégie de ces dirigeants policiers consiste à se poser en « experts » des questions de délinquance, faisant admettre qu’ils sont les mieux placés pour en parler puisqu’ils la côtoient tous les jours, mais faisant du même coup oublier qu’ils sont ainsi juges et parties.
A ce lobbying syndical va s’ajouter une évolution des Renseignements Généraux (RG). D’ordinaire, les policiers en activité s’expriment surtout par le biais de rapports internes. S’agissant des services de renseignement, leur discrétion semblait même une règle de fonctionnement. Or, dans les années 1990, une des figures les plus médiatisées de ce débat sur la « violence urbaine » sera la commissaire Lucienne Bui Trong, responsable de la section « Villes et banlieues », créée en 1991 à la suite des émeutes. Son action vise là encore à défendre le point de vue policier :
une chose me tenait particulièrement à cœur en ce printemps 1991 : je voulais rendre justice aux policiers de terrain ou tout au moins les dédouaner des accusations de discriminations au faciès dont ils étaient trop systématiquement l’objet. Je souhaitais aussi que le ministre de l’Intérieur prenne conscience de ces quelques vérités et comprenne mieux le mécontentement de ses hommes face à certains discours médiatiques ou politiques (Violences urbaines. Des vérités qui dérangent, 2000).
L’on comprend alors la nature de l’outil d’évaluation que ce service des RG mettra au point : l’« échelle d’évaluation de la violence urbaine ». Pour l’essentiel, cette échelle mesure non pas les phénomènes de violences en général (et encore moins l’ensemble des crimes et délits dont la population pourrait être victime), mais principalement les tensions surgissant entre les jeunes et les représentants de l’État et en premier lieu les policiers. Il y a là ce que l’on a appelé un « corpocentrisme » (Mucchielli, 2000) d’autant plus important à identifier comme tel que cette échelle d’évaluation va rapidement constituer l’un des principaux points d’appui de cette « nouvelle expertise policière ». Cette expertise aura en effet un atout de poids : la production de statistiques et l’usage d’arguments d’autorité tirés de chiffres dont on suggère qu’ils « parlent d’eux-mêmes », ce que beaucoup d’hommes politiques et de journalistes auront – ou feindront d’avoir – la naïveté de croire. La prétention à la mesure des « violences urbaines » enfreindra pourtant les règles les plus élémentaires de la statistique en présentant des augmentations de faits recensés annuellement sans indiquer que la définition des faits en question pouvait être élargie (modification de l’unité de compte), ni que la base territoriale où les faits étaient observés s’accroissait au fil des ans (modification de la population d’enquête).
Sur le fond, l’ensemble de ces auteurs dresse un tableau alarmant de la délinquance. Ces quartiers produiraient une jeunesse désocialisée, déscolarisée, pourvue de parents « démissionnaires », se retrouvant de fait sans repères moraux et sociaux ; ces jeunes seraient massivement toxicomanes et, pour consommer comme pour s’enrichir, ils deviendraient fatalement de jeunes trafiquants de drogue qui ne tarderaient pas à former des bandes délinquantes et armées, organisant toute une économie souterraine dans leur cités et terrorisant les territoires environnants. C'est ainsi que les incendies de voitures ne serviraient qu'à faire disparaître les voitures volées, tandis que les émeutes ne seraient en rien l’expression d’un sentiment d’injustice mais bien plutôt un moyen de tenir à distance la police pour mieux protéger ces trafics. Et, dans cette organisation délinquante, les plus âgés initieraient les plus jeunes. Ainsi se mettrait progressivement en place un véritable « système mafieux », organisé autour de quelques « familles délinquantes » contrôlant tout un quartier et utilisant les jeunes pour se protéger de la police. Et il ne s’agirait pas de n’importe quelles familles, mais des maghrébines. Le commissaire Bousquet en donnera cette explication :
jugé peu dangereux par la tradition et la culture de populations d’origine maghrébine, légitimé par son impact économique positif, le trafic de haschisch structure les emplois du temps et soutient la capacité de consommation du quartier. Facteur de paix sociale, il maintient sur le quartier le voile du silence mafieux.
Arriveront ensuite l’Islam et le risque terroriste, le cas de Khaled Kelkal et des attentats de 1995 faisant figure de signe annonciateur de l’avenir. Face à ces « nouvelles menaces », que les pouvoirs publics n’auraient pas prises au sérieux, face ainsi à « la dérive suicidaire de notre société » (commissaire divisionnaire Ventre, secrétaire général du SCHFPN) la police apparaît alors comme le dernier rempart.
En résumé, cette nouvelle expertise policière invite 1/ à accréditer l’idée d’un engrenage fatal dans la délinquance, 2/ à évacuer toute dimension politique du comportement agressif des jeunes envers les institutions, 3/ à écarter l’hypothèse d’une coresponsabilité policière dans la tension permanente qui anime certains quartiers ainsi que dans le déclenchement des émeutes, 4/ à défendre une conception uniquement répressive du métier de policier.
Pour autant, dans ses structures d’argumentation, dans ses présupposés et dans la vision du monde qu’il véhicule, ce discours policier sur les « violences urbaines » n’est guère original. D. Monjardet (1996) a prévenu que
dans l’exercice délicat qui consiste à affirmer du même mouvement sa propre excellence, la gravité toujours croissante du problème dont on s’occupe, et la nécessité de lui accorder toujours plus de ressources, le corps policier trouve un principe à la fois de dramatisation permanente et de revendications incessantes.
Ce sociologue de la police a montré aussi que le discours policier est classiquement dominé par deux éléments :
1/ la dénonciation de « la dissolution du principe d’autorité dans la société dont il est le contemporain, et les pratiques de renvoi de la responsabilité de toute une série de difficultés de sa pratique quotidienne aux autres institutions, qui n’assureraient plus la transmission et le respect de l’autorité, comme la famille, l’école et la justice » ; 2/ « les difficultés endémiques entre la police et les groupes sociaux qui, pour des raisons structurelles, se plient moins facilement que d’autres à cette imposition d’autorité : les jeunes et les minorités ethniques.
Cette mise en scène dramatisée de la « dérive mafieuse » des « cités interdites » et autres « zones de non droit » connaîtra pourtant un réel succès. En particulier lorsque la « gauche plurielle » de retour au pouvoir en 1997 reprendra à son compte l’expression « violence(s) urbaine(s) » en cherchant à dépolitiser le thème de la sécurité, ce qui aura plutôt pour effet de libérer les discours catastrophistes des risques d’étiquetage idéologique et de protestation des organisations antiracistes (Bonelli, 2008). De surcroît, utilisant massivement ce discours policier et s’associant parfois à ses représentants, d’autres nouveaux « experts », liés au développement du marché privé du diagnostic de sécurité, se sont alors propulsés aux devants de la scène publique, avec d’efficaces stratégies de communication en direction des médias. L’analyse de l’usage de l’expression « violence urbaine » dans les dépêches de l’AFP et les titres des quotidiens nationaux révèle ainsi une envolée en 1998 (Macé, 2002). Les campagnes électorales de 2001 et 2002 viendront enfin consacrer politiquement des discours qui n’ont du reste pas disparu par la suite. Ils sont au contraire recyclés périodiquement dans des sociétés occidentales où la peur de l’avenir et le sentiment d’insécurité constituent de puissantes armes électorales (Mucchielli, 2008).
Reste que, si la notion de « violence(s) urbaine(s) » doit être écartée de l’analyse sociologique, les phénomènes qu’elle amalgame n’en font pas moins partie de la réalité. S’imposent donc, en retour, d’autres catégories d’analyse et outils d’interprétation.
Au terme d’une typologie qui accorde généralement les praticiens comme les chercheurs (Le Goaziou, Mucchielli, 2009), on peut distinguer trois types de délinquance juvénile. Le premier, dit « initiatique », concerne non pas une minorité mais la majorité des adolescents qui, un jour ou l’autre, font l’expérience de la transgression (fraude, vol, bagarre, consommation de cannabis, conduites à risque), le plus souvent dans l’émulation d’un petit groupe de pairs. Les enquêtes de délinquance auto-déclarée révèlent cette banalité de l’expérience déviante à l’adolescence et n’y associent aucun facteur psychosocial discriminant. A l’opposé, le second type, dit « pathologique », rend compte du fait qu’une toute petite minorité d’adolescents a des comportements déviants et agressifs, qui se manifestent souvent depuis l’enfance, en liaison avec des problématiques familiales lourdes. Enfin, le troisième type, dit « d’exclusion », désigne ceux des adolescents qui, après les éventuelles initiations, persistent dans des pratiques délinquantes et restructurent leur identité autour du rôle délinquant, parfois dans le cadre de « bandes » plus ou moins structurées (Mohammed, 2007). Ceux-là font une carrière plus ou moins longue dans la délinquance et sont bien connus du système pénal. Les facteurs sociaux les distinguant le plus des autres types sont le fait d’avoir grandi dans un quartier pauvre et l’échec scolaire.
Cette typologie permettait déjà de décrire largement la délinquance juvénile dans les années 1960 et aucun type n’est spécifique aux quartiers en voie de ghettoïsation. Cependant, la concentration des handicaps socio-économiques des familles, le niveau très élevé de l’échec scolaire, la violence réciproque des relations quotidiennes des jeunes avec la police, le poids du stigmate lié aux « origines » et enfin les opportunités liées à la présence de trafic de cannabis, constituent de puissants accélérateurs de délinquance. Au point que l’on finit par croire spécifique à ces quartiers ce qui n’y est que plus fréquent et peut-être davantage réprimé.
Enfin, la notion de « violence(s) urbaine(s) » vise aussi à imposer une lecture des émeutes en simples termes de délinquance, ce que démentent les recherches sociologiques [voir entrée « Émeutes en France »]. Si la reformation de « ghettos urbains » (Lapeyronnie, 2008) et la violence de l’expérience des discriminations a notamment pour effet de générer de la défiance et parfois de l’agressivité envers les institutions et tous ceux qui les représentent, les émeutes cristallisent un profond malaise social et fédèrent les habitants de ces quartiers bien au-delà des petits groupes délinquants. Elles surviennent de surcroît le plus souvent en réaction à des violences policières.
Septembre 2010
Références
- Bonelli L., 2008, La France a peur. Une histoire sociale de l’insécurité, Paris, La Découverte.
- Lapeyronnie D., 2008, Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, Paris, Robert Laffont.
- Le Goaziou V., Mucchielli L., 2009, La violence des jeunes en question, Nîmes, Champ social.
- Macé E., 2002, Le traitement médiatique de la sécurité, in Mucchielli L., Robert Ph., dir., Crime et sécurité : l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2002.
- Mohammed M., 2007, La formation des bandes de jeunes, Thèse de doctorat de sociologie, Université Versailles Saint-Quentin.
- Mucchielli L., 2000, L’expertise policière de la « violence urbaine ». Sa construction intellectuelle et ses usages dans le débat public français, Déviance et société, n°4.
- Mucchielli L., dir., 2008, La frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, Paris, La Découverte.
- Monjardet D., 1996, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, La Découverte.
- Rey A., 1996, La peur des banlieues, Paris, Presses de Sciences-Po.
Émeutes en France
Publié par BD-SLL
Le mot Émeute provient du verbe Émouvoir. Du haut Moyen Age à la Renaissance, une Esmote désigne une émotion collective prenant la forme d’un soulèvement populaire spontané. « Tumulte séditieux, soulèvement dans le peuple », indique le Dictionnaire de l’Académie française au milieu du 18ème siècle. Et le sens ne variera jamais.
Les émeutes françaises contemporaines ont lieu dans les quartiers populaires d’habitat collectif frappés par la désindustrialisation et le chômage, habités massivement par des familles d’ouvriers et d’employés dont beaucoup proviennent des grands flux migratoires des années 1950-1970 (Portugais, Maghrébins puis Noirs Africains) qui s’y sont installées avec la résorption des bidonvilles puis la politique du regroupement familial. Elles surviennent généralement à la suite de la mort d’un ou plusieurs jeunes du quartier concerné, le plus souvent en relations (diverses) avec une opération de police. Elles sont l’œuvre de garçons, grands adolescents et jeunes majeurs, souvent chômeurs ou inactifs, parfois ouvriers précaires ou apprentis, ou encore scolarisés dans les filières professionnelles les moins valorisées ; la plupart sont « issus de l’immigration » ; ils ne sont structurés par aucune organisation politique et n’affichent en apparence aucune revendication. Leur « répertoire d’action collective » (C. Tilly) réside principalement dans l’incendie de véhicules et l’affrontement avec les forces de l’ordre. Dans certains cas, les incendies visent aussi des bâtiments et certains magasins peuvent être pillés.
L’émergence
Le phénomène est apparu dans la seconde moitié des années 1970, dans certains quartiers pauvres de l’agglomération lyonnaise. Avec la médiatisation des événements du quartier des Minguettes à Vénissieux en juillet 1981, le phénomène apparaît aussi en région parisienne. L’émeute se fixe donc au tournant des années 1970 et 1980. Analysant cette époque, C. Bachmann et N. Leguennec (1996) écrivent : « Contre qui se battent les émeutiers ? Contre un ennemi sans visage. Contre ceux qui les nient quotidiennement, les condamnent à l’inexistence sociale et leur réservent un avenir en forme d’impasse. […] Aucun allié, aucune issue. L’univers symbolique des banlieues donne à lire un partage manichéen : les pauvres tristes et humiliés contre les riches puissants et enviés. […] S’il est une revendication qui s’affirme haut et clair, c’est bien celle d’une sensibilité à vif : obtenir un minimum de considération, bénéficier d’une reconnaissance, conquérir le respect. Ces deux sentiments forts, la sensation de l’impasse et la conscience du mépris, sont toujours à la racine des fureurs banlieusardes ».
Durant les années 1980, plusieurs phénomènes se conjuguent pour chasser l’émeute de la scène publique. D’abord la réaction du gouvernement (socialiste) de l’époque. Outre les opérations de prévention lancées l’été suivant, qui envoient plus de 100 000 jeunes des quartiers les plus « sensibles » en vacances ou bien les occupent sur place, plusieurs politiques publiques sont initiées en direction de l’insertion professionnelle, de l’école, de la prévention de la délinquance et de l’aménagement urbain. Le gouvernement a aussi libéré les ondes radiophoniques et ouvert aux étrangers la liberté d’association. Ensuite, un événement politique va ouvrir une perspective de reconnaissance symbolique pour ces jeunes « issus de l’immigration », au moment même où le racisme qu’ils dénoncent est comme consacré officiellement par l’émergence de l’extrême droite (le Front national) sur la scène électorale. Dans le même quartier des Minguettes, suite à une « bavure policière » qui menace de déclencher de nouveau l’émeute, des jeunes, fortement soutenus et conseillés par un prêtre, initient une nouvelle forme d’action collective : une grande marche non violente à travers la France. Cette « Marche des Beurs » connaîtra en 1983 un succès politico-médiatique important et suscitera une intense activité associative et politique encouragée en particulier par le Parti socialiste, qui suscite et contrôle la création de SOS Racisme.
L’enracinement
À l’enthousiasme de la première moitié des années 1980 va cependant succéder la désillusion. Tout d’abord, les politiques publiques initiées semblent impuissantes face à la montée du chômage de masse : de presque 500 000 chômeurs en 1974, on est passé à 2,5 millions en 1985. Dans les quartiers désindustrialisés, le taux de chômage des jeunes peu ou pas diplômés atteint 30% en 1990. Ensuite, sur le plan politique, le « mouvement Beur » n’a pas réussi à se structurer. Le besoin insatisfait de reconnaissance et de participation se mue alors en repli sur soi et en affirmation de sa différence hors du champ politique. La culture Hip-hop connaît un succès grandissant auprès de la jeunesse des quartiers, dont une partie opère progressivement un retour vers le religieux qui fait rapidement l’objet d’une désapprobation dans un pays structuré par une culture républicaine farouchement laïque. En 1989, éclate « l’affaire du foulard islamique » qui cristallise une nouvelle peur de l’Islam et isole politiquement encore davantage les descendants des immigrés Maghrébins désormais suspectés de « communautarisme ». La parenthèse du début des années 1980 est terminée. La violence émeutière va revenir en force et s’installer durablement dans la société française.
En l’espace de huit mois (d’octobre 1990 à mai 1991), une série d’émeutes éclatent, à Vaulx-en-Velin, Argenteuil, Sartrouville et Mantes-la-Jolie, et retentissent fortement dans le débat public. En comparaison avec l’été 1981, les rapports entre jeunesse des quartiers et police urbaine ont monté d’un cran dans la violence et l’émeute s’est aussi accompagnée de pillages et de dégradations importantes. Le « rodéo » semble désormais un euphémisme, le mot « émeute » s’impose dans le débat public et la comparaison avec l’Angleterre voire les États-Unis devient courante. Les syndicats de police font pression sur les pouvoirs publics et les médias, ils popularisent l’expression de « violence urbaine » [voir l’entrée dans ce dictionnaire] pour désigner un ensemble d’actes délinquants dont l’émeute ne serait qu’une forme, ils cherchent à accréditer l’idée de quartiers devenus des « zones de non droit » contrôlées par des trafiquants de drogues. Dans le champ politique, l’incompréhension voire la réprobation est d’autant plus grande que beaucoup de ces villes ont fait l’objet de politiques sociales et éducatives, mais sans avoir recherché davantage de participation et de démocratie locale, laissant donc aux habitants le sentiment que les choses se font sans eux. Le gouvernement, de nouveau socialiste, réagit en créant le ministère de la Ville et en faisant voter en 1991 une loi d’orientation sur ce qui s’appellera désormais « la politique de la ville » et ses « quartiers prioritaires ». Mais il renforce aussi le contrôle policier de ces territoires en créant une section des Renseignements généraux destinée à les observer et une nouvelle unité de choc de la police urbaine : les Brigades anti-criminalité (BAC). Par delà les alternances politiques, ces deux types de politiques publiques (ville et sécurité) guideront l’action des gouvernements jusqu’à nos jours, sans parvenir à renverser la donne. Depuis 1990, des émeutes locales ont éclaté quasiment chaque année.
La généralisation
Enfin, entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005, l’émeute perd son caractère localisé pour s’étendre à l’ensemble du territoire national. Pour la première fois, une émeute se déroulant dans un quartier d’une ville a des répercussions à des centaines de kilomètres, elle suscite un processus d’identification collective. Et dans la mesure où les télévisions montrent des voitures en feu depuis 25 ans, ce processus ne saurait s’expliquer par sa médiatisation. Durant trois semaines, des incidents – de gravité très diverse – surviennent dans près de 300 communes, occasionnant 10 000 incendies de véhicules particuliers et plusieurs centaines d’incendies ou de dégradations à l’encontre de bâtiments publics, notamment scolaires. La répression est lourde. La panique est telle au sommet de l’État que le Premier ministre décide de recourir au couvre-feu. Le 8 novembre, est décrété l’état d’urgence, en application d’une loi du 3 avril 1955, prise au temps de la Guerre d’Algérie.
Comment expliquer ce phénomène ? Les émeutiers interviewés dans la région parisienne donnent deux séries de raisons à leur colère (Mucchielli, Le Goaziou, 2007). Les premières sont relatives aux événements de Clichy-sous-Bois et à l’attitude des pouvoirs publics. C’est ce qui est considéré comme un déni et un mensonge de la part des autorités qui fonde l’indignation et donc le sentiment de légitimité morale de la colère émeutière. Les secondes raisons évoquent non pas le contexte de l’émeute mais certaines dimensions de l’expérience de vie quotidienne de ces jeunes, qui nourrit en profondeur « la rage » et « la haine ». Cette expérience révèle d’abord un vécu d’humiliations multiples accumulées. Viennent d’abord les souvenirs les plus forts. Certains racontent des expériences de discriminations à l’embauche, voire font du racisme une explication généralisée. La plupart font remonter leur sentiment d’injustice et d’humiliation à l’école. Enfin, tous disent que la source quotidienne de leur sentiment d’injustice et d’humiliation est leur relation avec la police, avec moult récits. Ensuite, en orientant l’analyse vers leurs conditions de vie générale, il apparaît que cette expérience est liée à l’absence de perspective d’intégration sociale, et d’abord au chômage dont le niveau n’a cessé d’augmenter durant les années 1990, creusant les écarts en fonction des niveaux de diplôme, maximisant les frustrations économiques et sociales des moins diplômés et accroissant le caractère durablement discriminatoire des parcours scolaires. Cette non insertion économique pèse sur l’ensemble du processus d’intégration sociale et d’entrée dans la vie adulte. Derrière l’absence d’emploi et donc de revenu, se profile en effet l’impossibilité matérielle du départ du domicile des parents pour accéder à un logement personnel ainsi que la difficulté objective à envisager une union conjugale et un projet familial. C’est l’ensemble de ce parcours conçu et attendu comme « normal » par tout jeune qui se trouve au mieux durablement contrarié, au pire perçu comme inaccessible. En d’autres termes, la non insertion économique n’est pas seulement une « galère » au quotidien, elle a des conséquences sur toute la perception de l’avenir et la vision du monde que se construisent les aînés ainsi que les cadets qui les observent. Enfin, elle a des répercussions au sein même des familles, sur les relations entre les générations. Dans cette colère vengeresse des jeunes durant les émeutes, que leurs parents et leurs grands frères disent souvent désapprouver sur la forme mais comprendre sur le fond, l’on peut lire ainsi une dimension plus collective encore.
L’émeute comme forme élémentaire de la protestation
Malgré cela, la violence n’est pas et n’a jamais été le seul langage pratiqué par cette jeunesse, pour peu qu’elle rencontre le soutien voire la collaboration d’autres forces sociales ou politiques. C’est dans les mêmes quartiers de la banlieue lyonnaise où s’inventèrent les émeutes à la fin des années 1970, que se développèrent des grèves de la faim et d’autres tentatives de mobilisations politiques des travailleurs immigrés (contre des agressions racistes, contre des violences policières, contre des expulsions, pour réclamer l’égalité des droits dans l’entreprise ou le droit de vote local), soutenues par les Églises et des associations militantes de gauche. C’est du même quartier émeutier des Minguettes qu’est parti le « Mouvement Beur » de 1982-83. Ceci révèle la nature « interpellative » de l’émeute, le besoin de reconnaissance qu’elle porte. Les émeutiers ne réclament aucune révolution, ils ne contestent pas le système social et politique, ils en dénoncent l’hypocrisie et les constantes humiliations ou « violences symboliques » (P. Bourdieu). Les protestations collectives ne traduisent pas seulement des conflits d’intérêts, elles portent aussi des attentes morales, des sentiments d’honneur collectif bafoué, de mépris et de déni de reconnaissance (A. Honneth). Contrairement à une peur croissante dans la société française, les émeutes contemporaines ne s’articulent pas sur un communautarisme ni sur une revendication d’autonomie par rapport aux règles démocratiques régissant la société globale. Les jeunes « issus de l’immigration », émeutiers comme non émeutiers, réclament non pas la possibilité de vivre selon des règles générales différentes de celles qui régissent la vie de la communauté nationale, mais le droit de participer pleinement à cette vie et à ces règles tout en étant reconnus et respectés dans leurs spécificités relatives.
Ainsi, l’émeute témoigne en creux de l’absence d’autres possibilités de contestation et pose in fine la question des médiations et de la représentation politiques. Par là, elle révèle le déficit de ces deux dimensions de l’intégration dans le système politique français. Déficit des médiations politiques entendues comme l’ensemble des interventions destinées à permettre un dialogue au besoin conflictuel entre les habitants de ces « zones urbaines sensibles » et les décideurs politiques ou administratifs. Les trois dernières décennies ont enregistré le déclin historique des formes d’encadrement et de politisation liées aux partis politiques, aux syndicats ainsi qu’aux mouvements de jeunesse et aux mouvements d’éducation populaire laïques ou religieux. Ceci n’empêche pas le secteur associatif d’être parfois dynamique, notamment à travers la politique de la ville, mais ces associations et les élites intermédiaires locales qu’elles pourraient faire émerger sont le plus souvent, soit maintenues en marge du jeu politique proprement dit, soit instrumentalisées dans le clientélisme municipal et dans un système d’« achat de la paix sociale ». Double déficit, ensuite, de demande et d’offre politiques. Outre que le droit de vote des étrangers non européens aux élections locales n’a jamais été décidé, l’échec du « mouvement Beur » des années 1980 puis la stigmatisation croissante des « arabo-musulmans » dans le débat politico-médiatique a éloigné cet électorat de la gauche dont il était le plus proche, puis l’a éloigné du vote tout court. Du côté de l’offre politique, le déficit d’intégration de représentants de ces populations dans les sections locales des partis et dans les équipes municipales au pouvoir est patent. Enfin, comme les réactions de la classe politique aux émeutes de 2005 l’ont montré, aucun parti ne se pose en défenseur des habitants des quartiers populaires. Le constat est massif du côté du Parti socialiste qui domine l’échiquier politique à gauche depuis vingt-cinq ans mais dont les militants comme les électeurs se sont progressivement coupés des milieux populaires. Mais il vaut également dans une large mesure pour les anciennes « banlieues rouges », ces villes ouvrières contrôlées politiquement durant des décennies par le Parti communiste. Il vaut enfin pour l’extrême gauche. De sorte que les électeurs Français « issus de l’immigration » ne trouvent nulle part sur l’échiquier politique le moyen de promouvoir leurs revendications ni même d’exprimer un équivalent du « vote protestataire » en faveur de l’extrême droite d’une partie des ouvriers « Français d’origine française ».
Septembre 2010
Références
Bachmann C. & Leguennec N., Violences urbaines, Albin Michel, Paris, 1996.
Beaud S. & Pialoux M., Violences urbaines, violence sociale, Paris, Fayard, 2003.
Kokoreff M., Sociologie des émeutes, Paris, Payot, 2008.
Lagrange H. & Oberti M., dir., Émeutes urbaines et protestations. Une singularité française, Paris, Les Presses de Sciences-Po, 2006.
Lapeyronnie D., « ‘Révolte primitive’ dans les banlieues françaises », Déviance et société, 4, 2006.
Lapeyronnie D., Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, Paris, Robert Laffont, 2008.
Mohammed M., « Les voies de la colère: ‘violences urbaines’ ou révolte d’ordre politique ? L’exemple des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne », Socio-logos, 2, 2007 [En ligne], URL : http://socio-logos.revues.org/document352.html
Mucchielli L. & Le Goaziou V., dir., Quand les banlieues brûlent. Retour sur les émeutes de novembre 2005, Paris, La Découverte, 2ème éd, 2007.
Santé et justice
Publié par BD-SLL
Bien qu’on les conçoive comme des systèmes distincts, répondant à des situations-problèmes différentes et poursuivant des finalités qui leur sont propres, les systèmes de santé et de justice criminelle sont, dans les faits, étroitement liés. On peut lister plusieurs exemple de la fluidité, sinon de l’artificialité, des frontières entre ces deux système : la criminalisation de l’exposition au VIH, la participation du personnel infirmier dans la mise à mort par injection dans certains pays ou États où la peine de mort existe toujours ou encore la pratique qui consistait historiquement à détenir les infracteurs pour une période indéterminée jusqu’à ce qu’ils soient « guéris ». D’ailleurs, le travail de distinction entre santé et justice criminelle mobilise une énergie constante. En effet, au moins deux des trois sous-systèmes compris traditionnellement dans l’appellation justice criminelle (la police et les tribunaux) possèdent des mécanismes de triage officiels pour limiter la pénalisation de la maladie ou de troubles médicalisés. Dans le troisième sous-système de la justice criminelle, soit l’appareil correctionnel, il s’agit moins de triage que de gestion des problèmes de santé, tant ceux présents lors de l’entrée en détention que ceux qui se développent au fil de la sentence d’incarcération. À plus large échelle, avec le mouvement Prisons en santé (Health in Prisons), mis de l’avant par l’Organisation mondiale de la santé, les prisons et les détenus sont appelés à devenir des vecteurs de santé de toute la communauté, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes.
Éviter la judiciarisation et la pénalisation des problèmes de santé: L’étape des services policiers et des tribunaux
D’une part, les services policiers sont appelés à être des intervenants de première ligne dans nombre de situations-problèmes (conflits interpersonnels, troubles de l’ordre public, etc.). D’autre part, ils sont souvent décriés pour se saisir massivement d’une population marginalisée et affectée par des maux individuels et sociaux qui s’expriment notamment par et dans le corps ou la santé des individus (problèmes psychosociaux, dépendance à la drogues, itinérance, etc.). Devant un tel dilemme, des programmes de déjudiciarisation (diversion) ont été mis en place. En Amérique du Nord ils datent de la fin des années 1980. Des intervenants psychosociaux accompagnent ou sont appelés à la rescousse des policiers pour évaluer et faire face à des situations qui exigent une intervention immédiate en termes de soins plutôt qu’une arrestation. L’objectif est d’éviter la prise en charge des personnes concernées par le système de justice criminelle et de les diriger vers les ressources appropriées (hôpitaux, clinique d’urgence, service d’hébergement, etc.) pour cibler la cause à la source de la situation-problème (Otero et al., 2005).
Toutefois, si ce premier mécanisme de déjudiciarisation des problèmes de santé achoppe, un deuxième filtre peut intervenir soit la déjudiciarisation faite à l’étape de la poursuite où le procureur de la Couronne choisi de référer la personne à des ressources socio-sanitaires plutôt que de procéder officiellement avec les accusations. Plus avant, dans maintes juridictions nord-américaines, des tribunaux spéciaux (problem-solving courts) sont mis en place, notamment des tribunaux de traitement de la toxicomanie (drug treatment courts) et des tribunaux de la santé mentale (mental health courts). Souvent associé au mouvement de la jurisprudence thérapeutique (therapeutic jurisprudence), ces mécanismes souscrivent à l’idéal selon lequel l’application de la loi doit engendrer des bénéfices pour la personne qui y est soumise et non pas viser sa pénalisation. La possibilité de procéder par les tribunaux spéciaux, plutôt que par la voie régulière, est offerte aux personnes qui ont commis des délits mineurs qui sont directement liés à la drogue ou sont l’expression de troubles psychosociaux. Cette filière est volontaire et la personne concernée peut, en tout temps, demander le transfert de son dossier vers un tribunal usuel.
Les tribunaux spéciaux offrent la possibilité de retirer les accusations ou encore s’engagent à ne pas imposer de sentence d’incarcération en échange de la participation de la personne concernée à un programme structuré pour une durée déterminée. Des conditions sont imposées et une équipe composée d’un juge et de procureurs ayant une sensibilité particulière aux problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, de travailleurs sociaux, de criminologues et d’autres spécialistes veillent à leur application. Peu d’études empiriques concluantes ont été réalisées à ce jour pour évaluer la capacité des tribunaux de traitement de la toxicomanie à réduire la judiciarisation, la récidive et les coûts financiers associés, trois objectifs mis de l’avant par ces mécanismes (Werb et al., 2007).
Les résultats partiels semblent démontrer que peu des participants qui entament le suivi avec les tribunaux de traitement de la toxicomanie le terminent, une très large proportion retournant à la voie judiciaire usuelle. L’abstinence totale exigée peut expliquer en partie le faible taux de rétention. Plus encore, les personnes ainsi supervisées ont un taux d’accusation pendant et après le programme qui équivaut à celui des toxicomanes qui ont suivi la voie judiciaire régulière. Finalement, le passage des tribunaux de traitement de la toxicomanie aux tribunaux réguliers que plusieurs opèrent est susceptible d’allonger leur prise en charge et, ce faisant, les frais associés.
Concernant les tribunaux de santé mentale, les résultats de recherche sont plus encourageants (Jaimes, Crocker, Bédard, & Ambrosini, 2009). Certaines études indiquent que les personnes qui optent pour la déjudiciarisation par les tribunaux de santé mentale passent moins de temps incarcérées, récidivent moins à la suite du programme et fonctionnent mieux en société. Finalement, les fonds investis dans les tribunaux de santé mentale sont récupérés par les économies réalisées dans les tribunaux réguliers qui n’ont plus à se saisir de cette clientèle. Malgré les mécanismes de déjudiciarisation mis en place dans les services de police et les tribunaux pour éviter la prise en charge par la justice criminelle des problèmes de santé, la prison se présente de plus en plus comme un lieu privilégié de prestation et d’utilisation des services de santé pour la population marginalisée.
Du triage à la gestion: Prestation et utilisation des soins de santé en détention
Suivant les échantillons sous examen, on estime que la proportion de personnes porteuses du VIH est 20 fois supérieure en détention que dans la population générale; environ 40% des femmes et plus de 30% des hommes détenus seraient porteurs de l’hépatite C; la tuberculose serait de l’ordre de 20% et les troubles mentaux sévères seraient courants dans la population carcérale. À ces problèmes repérés dès l’entrée en prison s’ajoutent des éléments qui surviennent tout au long du séjour en détention dont le vieillissement des populations carcérales attribuable, entre autres, aux sentences d’incarcération de plus en plus longues et les problèmes psychosomatiques engendrés ou exacerbés par l’incarcération. Avec une santé si mal en point, il n’est pas surprenant que les hommes et femmes détenus présentent des besoins élevés en matière de soins, ont environ deux fois plus de contacts avec le personnel médical que la population générale et consomment une grande quantité de psychotropes (Lafortune & Vacheret, 2009). D’ailleurs, pour des personnes qui vivent l’instabilité résidentielle et la précarité financière quand elles sont en communauté, la prison peut représenter l’occasion de prendre soin de problèmes de santé longtemps négligés. Tant pour la population en liberté que pour la population incarcérée, l’usage des soins est lié à leur accessibilité.
Or, malgré la qualité des soins offerts et prodigués, les programmes d’éducation et de dépistage, les programmes de pairs aidant et toutes les intentions louables, la prestation des soins de santé en détention demeurent caractérisées par ses défis (Holmes, Perron, Montuclard, & Hervé, 2005). L’asservissement des soins à la logique sécuritaire est durement ressenti dans certaines administrations pénitentiaires et empêche la continuité et le suivi médical au gré des reclassements, transferts et autres impératifs correctionnels. Le conflit entre les deux rôles attribués, dans certaines administrations, au personnel infirmier fait en sorte que celui-ci se retrouve coincé entre deux allégeances contradictoires qui nuisent à l’établissement du lien de confiance avec les patients. Ceci est illustré notamment par la difficulté à assurer le secret professionnel quand les examens médicaux sont menés en présence d’agents correctionnels ou encore devant l’obligation formelle pour le personnel soignant de rapporter au comité disciplinaire de l’établissement carcéral les pratiques non-réglementaires des détenus.
Ces difficultés ne découragent pas certains de proposer de formaliser le rôle des établissements carcéraux comme pourvoyeur de services et d’éducation sanitaire pour la population marginalisée. Il faut se souvenir que les détenus proviennent pour la plupart de groupes socio-économiquement défavorisés. Or, ces groupes, particulièrement les plus marginalisés d’entre eux, représentent souvent un défi pour les prestataires de services de santé, même les agences de santé communautaire qui tentent de développer des liens avec les résidents du quartier où elles se trouvent. Cette imperméabilité tient tant à la méfiance généralisée de ce segment de la population envers les appareils d’État, dont les services de santé, qu’au peu d’effet que les messages de santé publique ont sur les groupes marginalisés. La détention se présente alors pour les autorités de santé publique comme un contexte idéal pour « éduquer » ce segment de la population aux comportements sains. L’espoir de certains est qu’à travers les détenus, ce serait toute une couche impénétrable de la population qui s’ouvrirait ainsi aux messages de la santé publique.
Cette idée d’intégrer la santé et le milieu correctionnel se concrétisent dans des projets très précis. Ainsi, des chercheurs suggèrent de joindre, aux instruments correctionnels existant, une section sur le risque posé à la santé publique comme élément dans la prise de décision en matière de remise en liberté et de suspension de la libération conditionnelle des détenus. Dans un tel modèle, des comportements comme la consommation de tabac et de drogue (risques individuels), l’infection par une ou des maladies transmissibles (risques communautaires) et les coûts financiers associés au traitement des maladies (risques économiques liés à la santé) deviennent des informations incorporées dans le calcul des risques que les services correctionnels doivent tenter de minimiser. Les profils de risque, que ce croisement d’information permettra, faciliteront ainsi, d’après ces auteurs, une meilleure allocation des ressources correctionnelles et une meilleure protection de la communauté. Selon ce modèle, une personne présentant un faible risque criminel mais un fort risque économique lié à la santé pourra être transférée en communauté plus rapidement. En retour, ce même modèle permet aussi de punir des comportements de santé jugés à risque. Ainsi selon ce modèle un libéré conditionnel qui contracte ou transmet une maladie infectieuse peut être suspendu et réadmis en détention. Les infracteurs sont alors considérés et traités comme des risques de santé publique (Robert & Frigon, 2006).
Bref, santé et justice criminelle sont des secteurs en osmose et méritent d’être compris dans leurs relations plutôt qu’en vase clos. Pratiquement et politiquement, les arrimages entre eux peuvent nous amener à questionner le bien-fondé de rendre la santé d’une portion de la population tributaire de la punition.
Septembre 2010
Références
Holmes, D., Perron, A., Montuclard, L., & Hervé, C. (2005). Scission entre le sanitaire et le pénitentiaire : réflexion critique sur les (im)possibilités du soin infirmier au Canada et en France. Journal de Réadaptation Médicale, 25(3), 131-140.
Jaimes, A., Crocker, A., Bédard, É., & Ambrosini, D. L. (2009). Les Tribunaux de santé mentale : déjudiciarisation et jurisprudence thérapeutique. Santé mentale au Québec, XXXIV(2), 171-197.
Lafortune, D., & Vacheret, M. (2009). La prescription de médicaments psychotropes aux personnes incarcérées dans les prisons provinciales du Québec. Santé mentale au Québec, XXXIV(2), 147-170.
Otero, M., Landreville, P., Morin, D., & Thomas, G. (2005). À la recherche de la dangerosité 'mentale'. Stratégies d’intervention et profils de populations dans le contexte de l’implantation de la Loi P-38.001 par l’UPS-J. Montréal (pp. 222). Montréal: UQAM, Collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion sociale.
Robert, D., & Frigon, S. (2006). La santé comme mirage des transformations carcérales. Déviance et société, 30(3), 305-322.
Werb, D., Elliot, R., Fischer, B., Wood, E., Montaner, J., & Kerr, T. (2007). Les tribunaux de traitement de la toxicomanie au Canada. Examen basé sur les données. Revue VIH/SIDA, droit et politique, 12(2/3), 13-19.



