Police métier
Publié par BD-SLL
Article en voie de traduction
There is an endlessly elastic sociopolitical context within which policing operates. This elasticity results in shifting targets, deployment of resources, and new rhetoric that shapes the mandate over time through the stabilizing medium of the police métier. The police métier is a window into the ways in which policing shapes1 the social order in which it is located. This métier contrasts with how policing manages the mandate publicly. Rather, the police métier captures the show occurring backstage, characterized by occupational assumptions and practices focused around and reflexively shaping the incident.
Assumptions are made, as in any occupation, about the politics of the field, the etiquette of treating citizens, mistakes at work, and routines and performances required of the practitioners. This is the assumptive world in which the occupation operates. There is an assumed practical model or logic in action that informs choices made in line with these assumptions. These assumptions and connections are taken for granted as being in the nature of the work and how it is to be carried out. Police practices are verified with reference to the several compatible assumptions that produce them. The assumptions about policing are the context within which practices have a life and a social reality. They reflect the value of the assumptions, and the assumptions are the context within which the practices are lodged. They are mutually supportive and are logical and methodical.
- The police assume they know local areas, people, buildings, places, and their dynamics.
- The structural features of places, neighborhoods, corners, and niches, “pockets of crime,” as St. Jean (2007) terms them, are largely immutable.
- The people found in problematic areas are incorrigible. If they are drug dealers, they are “always dirty” (Moskos 2008, 83) and have no rights because they have forfeited them (ibid., 43–45) and can always be arrested (ibid., 49).
- Long-term “prevention,” “problem solving,” or efforts to change the contours of such neighborhoods have no purchase on shaping policing reality.
- Disorder can be altered superficially by local and personalized “treatments” and pragmatic, order-based policing.
- It is only possible to disrupt, briefly deter, and make the occasional arrest as needed to maintain the essential authority of the officer.
- Policing is differential by targets, time, place, and persons.
- Policing should be personalized in the sense that officers identify with their district or beat.
- While it is democratic in the sense of being responsive, policing in local areas, or neighborhoods, is shaped by ethnicity, class, time of day, and the political context. There is little one can do to change the economy, schools, family life, or religious values; these rarely change.
The Incident Focus
Domestic everyday policing is grounded in what might be called the cynosure of the incident (see Manning 2008, 81–82). Here, the métier is displayed.
In the police world, the incident is a microcosm of sensible, thoughtful, rational individualistic choices. It is the sacred center of policing. The idealized concept of the police officer transcends the actual officer in everyday practice. The officer is idealized as exceptional—he or she stands apart from malice, emotion, prejudice, or distorted perceptions. The sacred status attributed to the officer is complemented in law by the “reasonable man” legal standard. To call actions within an incident sacred is to reaffirm the nature of these social facts — they are obdurate, external, and constraining. Incidents involving corruption, violence, or showing personal everyday flaws such as anger, exultation, or depression are seen as rare by the media and the police and fall under the category of “rotten apples” and exceptions that prove the overall integrity of the police as a body.
The incident is framed or viewed organizationally exclusively as the officer at the scene describes it unless otherwise known. As Moskos writes, “The chain of command is a myth. A sergeant cannot be in active command of five units simultaneously (2008, 112). Moskos captures the “you had to be there” rule: “While an officer may believe that another officer handles certain situations differently, the idea that officers should be allowed to make their own decisions is never in question. If these decisions are wrong, then the officers will face the legal, departmental or physical consequences” (ibid., 112–13). What is left unsaid here, but revealed by the notion of absent supervision, creative writing, management of calls for service, and stops to avoid “trouble,” is the rarity of actual information that might be seen as showing an officer was “wrong” in his or her decisions. “Otherwise known” refers to review later by supervisors, captured by the media or a citizen’s camera, witnessed by third parties with an interest in the outcome, or observed as a result of the officer’s request for advice or backup. Given that the theatrical core of policing is thought to be patrol work, the incident is seen in the context of responsiveness to citizen demand for order and showing activity to supervisors, but it is virtually always a low-visibility matter seen metaphorically through the eyes of the officer.
The Métier’s Sustaining Practices
The first shaping force is the authoritative patterning of relationships called the organization. There is an abiding sense in which the work of the police is structured, that is institutionalized, routinized, unquestioned, done as if there was no other way to do it, taken for granted as to its effectiveness, purposes, and means. These constraints, social facts, make everyday work possible. They are valued up and down the hierarchy of the organization and in that sense are the deep structures that sustain meaning. The basic foundational assumption is that this organizing is functional and rational. The organization is designed to allocate officers to randomly patrol, mostly by automobile, to react and respond to calls, and to investigate “founded” (deemed valid as a result of police investigation of the report) calls. It is so structured and concentrates its resources at the bottom of the organization. The officers focus in the incident from whatever source to which they react. In this sense, “policy” is set on the ground by lower participants’ situated practices. This kind of policy results from decisions made quasi independently and seriatim by loosely supervised officers.
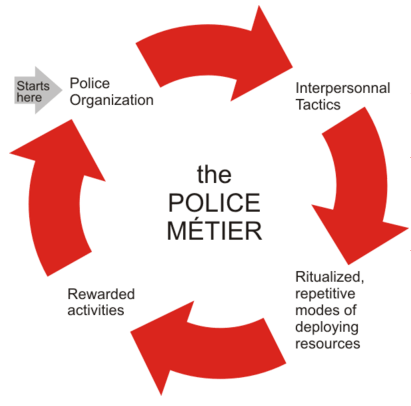
The second shaping force is interpersonal tactics in the incident. The sanctioned interpersonal tactics of policing are those thought to guarantee successful asserting of authority, taking control, closing the incident in some fashion, and returning to service. These are learned on the job from other officers and especially field-training officers, as the academic aspects of their training are viewed as irrelevant and even an impediment to doing good police work (discussed above as “police tactics.”) These constitute an aesthetic from which variation is permitted — a style — that has local departmentally shaped shadings.
The belief is that good policing, or a good piece of police work, has the following features. As a dramaturgical act, it requires:
- sizing up the incident quickly (the police joke is that the officer is supposed to have it sized up before arriving)
- dealing with the current situation in a parsimonious fashion
- avoiding violence or extended arguments
- deciding what to do and how to do it with dispatch
- minimizing paperwork
- producing solutions that facilitate returning to “service” (meaning becoming “available” — patrolling)
- reducing cogitations about eventual guilt or innocence of the parties
- eliminating remedies that are extensive, rehabilitative, educational, or transformative
The belief is that, once framed by the officer and handled in accord with these features, the incident has the social reality attributed to it by the officer. It takes organizational shape as the officer defines and describes it. A protective epigram protects and elevates judgments made on the scene: “You had to be there” (to understand what was done, why it was done, and the results produced). This epigram rules the occupational culture. It protects the officer from criticism or punishment. It has a patently irrational element in that it attributes to officers that which no one possesses: endless patience, insight into human deception, deep penetration into character, a wariness combined with trust, and a moderated “wait-and-see” attitude. Even researchers seek the buried but obvious reasonableness that must characterize police deciding. The idea that “distortions” are called upon suggests that the baseline of police deciding is of course reasonable, and somehow it must be shown by data that emotion, worry, guilt, anxiety, anger, and other mixed feelings exist in police shootings. This epigram and associated stereotype reinforce the inviolate and sacred center of the work — the reasonable, thoughtful, rational, cogitating individual officer, on the street deciding things. It provides for flexibility of action and freedom from close supervision. The officer’s account is virtually the rule of thumb in court as well: if the officer defines him- or herself as being in danger (or a police partner or member of the public), a shooting is considered prudent and legal (Hunt 1985). In addition, since the work is not defined in concrete terms or in terms of the content of the interactions involved, but rather is defined as a social form, what is done is open-ended and can be described using the conventional rhetoric sanctioned within the oral culture.
The third shaping force is repetitive modes of deploying resources. This is partially structural and partially processual — a result of how officers patrol. The repetitive modes of deploying resources (by beats, districts, and other territorially based obligations) ground “order” and ordering in places and doings more than in categories of crime, law, or morality. Policing is about the control of territory and the symbolization of that control. These deployment modes are sensitized by the list (above) of shifting targets, places, and people. In disadvantaged areas especially, where policing is expected as required, policing is played out as reflexive cybernetic policing. It responds to the known understandings of policing about where crime lies, in what areas of the city, and carried out by what groups of people, and during what hours, days, and months of the year. The records kept sustain the validity of the practices because they are based on the same assumptions.
The fourth force is the cluster of rewarded activities. Any organization operates by inducements and their distribution. These inducements to perform policing as expected are based on assumptions about how the social world of work operates, as well as what practices are necessary to cope with this world. These generally revolve around stops, arrests, and other visible interventions in areas known as being full of that potential. As discussed above, the absence of rewards for other activities — problem solving, developing partnerships, working with community groups, excellence in organizational politics (other than rank promotion) — continues to tie the organization to its symbolic crime-control emphasis and ritual attachment to routine stops and “showing activity.”
If we think of the incident as the window in which the practices are displayed, and these in turn being shaped by forces that are social facts, we can see that the incident is a ceremonial locus for repeating that which is valued and recognized as such in policing. In the incident the subjective and objective forces that govern the performance are mobilized. The activities have resemblance, coherence, and not a clear and obvious reality. Yet they are recognizable as “police work” in the here and now. The underlying continuity and resemblance between the actions may not be verbalized or described in nuance; the coherence is often assumed, not directly stated. The terms tied together by a fuzzy logic or like strands in a rope (Wittgenstein 1969) come to mind. They are known in spite of their emergent properties and complexity. These practices, and their existence as known properties of the incident, reproduce the modes of policing so frequently observed.
Notes
1. The term shapes can be only inferred from a number of studies of policing and its impacts as well as the available ethnographies and community studies of those policed.
Références
- Hunt, J. 1985. "Police accounts of normal force." Journal of Contemporary Ethnography 13:315.
- Manning, P.K. 2010. Democratic Policing in a Changing World. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
- _________. 2008. The technology of policing: crime mapping, information technology, and the rationality of crime control. New York: New York University Press.
- Moskos, P. 2008. Cop in the Hood: My Year Policing Baltimore's Eastern District. Princeton: Princeton University Press.
- St. Jean, Pierre 2007. Pockets of crime. Chicago: University of Chicago Press.
- Wittgenstein, L. 1969. The Blue and Brown Books. Oxford: Blackwell.
Sécurité privée
Publié par BD-SLL
La sécurité privée en tant qu’objet d’étude n’a commencé qu’assez tardivement à susciter l’intérêt des criminologues, soit à partir environ du début des années 1980 et des travaux fondateurs de Shearing & Stenning sur le royaume de Disney (1985). Pourtant, les formes privées de production de la sécurité ont toujours cohabité avec leurs contreparties publiques, que l’on pense aux traqueurs de voleurs anglais du XVIIe siècle, aux diverses formes de mercenariat au travers des âges ou encore à la création de la légendaire agence Pinkerton en 1850 (la première entreprise moderne de sécurité privée). Son entrée plutôt tardive dans le giron du savoir criminologique coïncide avec un accroissement spectaculaire de l’industrie de la sécurité privée depuis les années 1970 (Cunningham et al., 1990). Considérée comme une activité professionnelle somme toute marginale comparativement à la place occupée par le secteur public, les effectifs de la sécurité privée ont rapidement crû pour égaler, voire parfois dépasser les forces policières, atteignant le volume – impensable quelques décennies auparavant – de 3 employés de la sécurité privée pour un officier de police aux Etats-Unis (Cunningham et al., 1990). Bien qu’il soit très variable selon les pays (Jones & Newburn, 2006), l’accroissement est partout tangible ; les compagnies de sécurité privée ont foisonné, leurs rôles se sont diversifiés et leur légitimité s’est, bien que sur un rythme lent il est vrai, consolidée. Aujourd’hui devenue un acteur incontournable de la gouvernance de la sécurité, la sécurité privée est au centre d’une série de questionnements et de recherches criminologiques de plus en plus variés et nombreux. Nous allons ici nous pencher sur deux d’entre eux, soit : les difficultés de définition et les enjeux liés à son accroissement contemporain. Précisons que notre analyse s’applique avant tout à la réalité anglo-saxonne, qui a connu les développements les plus spectaculaires dans le domaine ; elle conserve cependant sa pertinence pour réfléchir à la sécurité privée dans d’autres régions du monde.
Questions de définition
La sécurité privée est un objet qui a bien du mal à satisfaire aux exigences d’une définition consensuelle. Elle se heurte en effet à une double inintelligibilité liée à ses deux composantes essentielles, la « sécurité » et le « privé ». Il n’est pas nécessaire de trop s’attarder sur la première, dont l’aspect protéiforme est évident (voir par exemple, Zedner, 2010, qui distingue la sécurité en tant qu’état objectif, état subjectif, pratique, symbole et poursuite). Bien que la sécurité s’applique en effet à une très grande diversité de domaines (emploi, santé, éducation, économie, système pénal, assurances, etc.), la sécurité privée, telle qu’étudiée par les criminologues, se restreint généralement aux activités (para)policières entreprises par le secteur privé et ne s’applique donc qu’à cette partie limitée de son champ sémantique. Le terme « privé », quant à lui, donne lieu à un amalgame fréquent, selon qu’il soit utilisé en référence à ce qui est personnel, intime (la sphère privée) ou qu’il prenne le sens d’opposition au secteur public, les actions étant orientées selon une logique de profit et non d’intérêt public (Shapland et Van Outrive, 1999). C’est la différence entre une milice de quartier (une initiative civile de sécurité) et l’industrie de la sécurité privée, deux catégories d’acteurs fort différentes qui se retrouvent parfois réunies sous le même sceau. Cette distinction se trouve par ailleurs troublée par l’existence d’acteurs qui empruntent aux deux acceptions du terme, telle que la sécurité corporative (une sécurité « doublement » privée, car elle ne regarde que l’entreprise et suit une logique marchande).
À ces premières difficultés, qui touchent à la pluralité de sens que peuvent prendre chacun des termes de l’équation, s’ajoute celle de la porosité de leur frontière, tout particulièrement en ce qui concerne la dichotomie public-privé. En effet, cette dernière est devenue aujourd’hui de plus en plus obsolète, tant l’imbrication des deux secteurs s’est complexifiée, la prolifération d’acteurs hybrides situés à l’intersection des secteurs public et privé étant un phénomène en constante progression (Johnston, 1992 ; Brodeur, 2003). Dès lors, il est de plus en plus délicat de catégoriser un acteur comme public ou privé, l’exercice dépendant de plusieurs facteurs qui peuvent entrer en contradiction. Par exemple, si l’on considère que la ligne de partage se situe dans la source de financement de l’activité de sécurité (une action de sécurité étant publique lorsque sa source de financement est d’origine étatique, privée lorsque les fonds proviennent d’acteurs non-étatiques), qu’en est-il des entreprises qui œuvrent en sous-traitance de l’État ? Et si l’on décide de mettre l’emphase sur le lieu de leur déploiement (l’espace public ou la propriété privée, dont la délimitation comporte elle aussi son lot de difficultés; Kempa et al., 2004), comment qualifier les agents de sécurité qui patrouillent une rue pour le compte d’une société de développement commercial ou tout autre regroupement de propriétaires immobiliers ? Et lorsque le client est une administration locale (une mairie d’arrondissement par exemple) ? Parce que la catégorisation d’une action de sécurité comme étant privée ou publique dépend de plusieurs variables, il est dès lors plus sage de faire usage du vocable « privatisation », une terminologie plus dynamique qui permet de mieux rendre compte de la réalité actuelle (Brodeur, 2003). Une action de sécurité peut ainsi être considérée comme étant plus ou moins privatisée ; il est possible dès lors de la situer sur un continuum, et non pas au sein de catégories souvent peu adéquates.
La sécurité souffre, elle, d’une définition « en creux », par la négative, en ce qu’elle se caractérise principalement par une absence de danger ou de menace. Elle reste donc difficilement palpable objectivement, la condition de sécurité n’existant tant et si longtemps qu’elle satisfait à cette absence (Ocqueteau 2004 ; Zedner, 2010). Elle évolue de manière relative à une incertitude dont l’ampleur permet de la qualifier : plus l’incertitude est faible, plus la sécurité est grande. Nous pouvons donc affirmer qu’elle existe à la fois en tant que but à atteindre et à la fois comme objectif inatteignable (ce qui tend à faire le bonheur de l’industrie ; Zedner, 2010) ; dans cet ordre d’idée, une situation, un lieu, un évènement est toujours plus ou moins sécurisé.
Il est donc possible de définir la sécurité privée comme étant l’ensemble des acteurs « privés » (avec toutes les difficultés que le terme comporte) dont l’activité principale consiste à faire diminuer, objectivement ou subjectivement, le degré d’imprévisibilité de la menace. Comme nous l’avons dit plus haut, la sécurité privée telle qu’étudiée par les criminologues se limite généralement aux actions de type policier, et la menace à son tour peut être circonscrite à celle qui pèse sur les personnes, les biens et l’information. Ceci nous rapproche de la position de Fourcaudot (1988) qui considère que la sécurité privée correspond à « l’ensemble des activités et des mesures, visant la protection des personnes, des biens et de l’information, fournies dans le cadre d’un marché compétitif, orienté vers le profit, et où les pourvoyeurs n’assument pas au regard de la loi, des responsabilités de fonctionnaires au service du gouvernement » (Fourcaudot, 1988 : 16). Cette définition exclut les initiatives civiles et précise, de manière étroite, le caractère privé d’un acteur (ne pas assumer de responsabilités de fonctionnaire au service du gouvernement). Bien qu’intéressant, l’ensemble ainsi défini demeure très éclaté (Brodeur, 2003), regroupant une grande diversité de secteurs d’activité : agents de sécurité (patrouille fixe et mobile), enquêteurs ou détectives privés, transporteurs de fonds, industrie de l’alarme, de la serrurerie et de la vidéosurveillance, développeurs de logiciels de protection des données, compagnies militaires privées, gardes du corps, videurs (bouncers), entreprises privées d’intelligence économique, agences de recouvrement, enquêteurs des assurances.
L’énumération ou la liste d’épicerie, une technique souvent utilisée pour circonscrire l’objet «sécurité privée», ne nous permet toutefois pas d’identifier le(s) dénominateur(s) commun(s) applicable(s) à l’ensemble des acteurs qui la constituent. Affirmer que la sécurité privée est composée de tels ou tels acteurs, bien qu’étant un exercice utile, notamment sur le plan juridique, ne nous informe pas forcément sur la substance de l’objet à définir. Parmi les quelques auteurs à s’être frottés à cet exercice périlleux, soulignons la proposition de Shearing & Stenning (1985) qui se décline en quatre caractéristiques : (1) La sécurité privée poursuivrait une logique instrumentale et non normative. (2) Elle serait de nature préventive. (3) Elle serait dépendante de la technologie. (4) Elle serait de nature non coercitive et fonctionnerait au consentement. Si l’on peut critiquer les trois derniers points (en arguant notamment de leur possible application à la police), la logique instrumentale de la sécurité privée permet de mieux comprendre et distinguer un secteur d’activités dont les rationalités sont largement ancrées dans des velléités instrumentales (satisfaction de la clientèle, prévention des pertes, etc.) et non à l’application de la loi, ni même au respect d’une quelconque norme morale. L’obéissance aux lois du marché et une philosophie tournée vers la prévention des risques sont au cœur de l’action de la sécurité privée (Ocqueteau, 1994).
De quelques enjeux
L’accroissement de l’industrie de la sécurité privée dans nos sociétés contemporaines soulève un certain nombre de questionnements. Il existe en premier lieu une crainte légitime d’assister à l’émergence d’une police privée. La disponibilité de produits et de services de sécurité sur le marché permet à de potentiels consommateurs fortunés d’obtenir une garde rapprochée personnelle, des systèmes d’alarmes, de caméras de vidéosurveillance, en bref une plus grande sécurité, relativement aux sections moins bien nanties de la société. Plus l’industrie est présente, plus la possibilité de voir apparaître des formes de polices privées augmente.
Cette peur doit toutefois être tempérée par l’absence de pouvoirs spéciaux donnés à la sécurité privée qui interdit d’établir une simple équivalence entre ce secteur et la police. Généralement non armés (à l’exception notable de certains employés de compagnies de transports de valeurs), les agents de sécurité privée ne jouissent à première vue d’aucun droit particulier d’arrestation, de détention et d’usage de la force, en dehors de ceux donnés au simple citoyen. Dès lors, il est faux de croire que la sécurité privée puisse véritablement devenir une forme de « police privée », en ce qu’elle est loin de se prévaloir des mêmes pouvoirs que la police publique (et, à ce titre, dépend inévitablement de cette dernière lorsqu’il s’agit de porter une affaire en cour, par exemple).
Il faut toutefois noter, à la suite de Shearing (1984), que les agents de sécurité évoluent souvent dans le cadre d’une propriété privée (tour à bureaux, centre commercial, centre culturel, complexe résidentiel, résidence clôturée, etc.) et qu’à ce titre les pouvoirs du propriétaire leurs sont délégués. Ceux-ci sont loin d’être insignifiants en ce qu’ils permettent à l’agent de sécurité, véhicule de l’autorité du propriétaire, d’interdire l’accès aux indésirables et d’expulser ceux qui ne se conforment pas aux règles établies. Ce pouvoir d’inclusion/expulsion est spécifique au propriétaire et, par extension, à l’agent de sécurité travaillant pour lui. Or, la multiplication des propriétés privées de masse et des espaces communs (Kempa et al., 2004) rend cette délégation de pouvoirs fort importante, les citoyens étant de plus en plus portés à évoluer au quotidien au sein d’espaces privés dont ils peuvent se faire expulser. Nous pouvons donc affirmer que s’il est faux de penser la sécurité privée comme concurrent direct de la police, il ne faut pas non plus la réduire à l’exercice d’une sécurité par de simples citoyens, et ce, même si la source du problème provient de la propagation de grands espaces privés ouverts au public au sein du tissu urbain et non pas de la sécurité privée directement.
Seconde catégorie d’interrogation, la marchandisation de la sécurité questionne le rôle de l’État dans la production, la distribution et le contrôle de la sécurité. Longtemps considérée comme subordonnée à l’État, l’industrie de la sécurité a démontré au fil des ans une capacité à l’indépendance qui aujourd’hui ne fait plus grand doute (Dupont, 2006). Cette propension à l’agir autonome est, à son tour, la source d’une remise en cause de la vision traditionnelle de la gouvernance de la sécurité et tout particulièrement du rôle joué par l’État. En effet, le soi-disant monopole de ce dernier est grandement mis à mal par l’apparition d’une industrie dont le volume dépasserait celui du secteur public et dont la capacité à produire des ordres privés de manière autonome ne cesserait de croître. De fait, l’inévitable renégociation des rapports de force qui en découle aboutit nécessairement à un affaiblissement de la centralité de l’État et de ses institutions dans la gouvernance de la sécurité. Bien que la police en reste l’un des acteurs majeurs, l’industrie de la sécurité privée a pris une place suffisamment significative pour que plusieurs auteurs parlent d’un changement profond dans la production, la distribution et le contrôle de ce bien public (Wood et Shearing, 2007). Le rétrécissement de la zone d’influence de l’État s’accompagne d’une accentuation de l’importance du marché comme source de régulation de la sécurité (Zedner, 2006), évolution qui vide également des polices publiques de plus en plus gérées comme des entreprises (Ayling et al., 2009). La sécurité est progressivement réduite à un simple bien de consommation, ce qui facilite et est facilité par une industrie dont le poids ne cesse d’augmenter. Et ceci a des conséquences qui dépassent le seul marché de la sécurité.
Conclusion
La sécurité privée est un objet protéiforme, aux frontières floues et qui regroupe une grande diversité de secteurs d’activité. Il n’est donc pas étonnant de voir Brodeur (2003) parler de sécurité privée comme d’un objet dont la caractéristique essentielle résiderait dans son éclatement. Pas plus qu’il ne faille être surpris de l’absence de consensus quant à sa définition. Il reste possible de mettre en exergue son caractère instrumental, sa dépendance aux lois du marché, une philosophie tournée vers la prévention du risque, ainsi qu’une action dirigée vers la protection des biens, des personnes et de l’information. Il est aussi évident que son importance, tant sur le plan pratique que symbolique, a connu une croissance si forte qu’il est aujourd’hui difficile d’imaginer que cette industrie puisse disparaître ou même simplement revenir au rôle et au poids qui étaient les siens au début des années 1970. La manière dont la sécurité des citoyens est produite aujourd’hui est fort différente de ce qui a pu exister auparavant. Et cette différence est en grande partie liée à l’industrie de la sécurité, que celle-ci en soit une conséquence, une cause ou les deux.
Références
- Ayling, Julie, Peter Grabosky et Clifford Shearing (2009) Lenghtening the arm of the law. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brodeur, Jean-Paul (2003) Les visages de la police: Pratiques et perceptions. Montréal: Presses Universitaires de Montréal.
- Cunnigham, W., J. Strauchs et C. Van Meter (1990) Private security trends, 1970 to 2000: The Hallcrest report, Boston: Butterworth-Heinemann.
- Dupont, Benoît (2006) “Delivering security through networks: Surveying the relational landscape of security managers in an urban setting”. Crime, Law & Social Change, 45, 165-184.
- Fourcaudaut, Martine (1988) Étude descriptive des agences de sécurité au Québec, Mémoire de maîtrise, Montréal, Université de Montréal, Faculté des études supérieures, École de Criminologie.
- Johnston, Les (1992) The rebirth of private policing. New York: Routledge.
- Jones, Trevor et Tim Newburn (2006) Plural policing: A comparative perspective. New York: Routledge.
- Kempa, Michael A., Philip Stenning et Jennifer Wood (2004) Policing communal spaces: A reconfiguration of the ‘mass private property’ hypothesis.” The British Journal of Criminology. 44/4: 562-581.
- Ocqueteau, Frédéric (1994) La sécurité marchandisée, Insécurité: question de confiance, 238, 63-72.
- Ocqueteau, Frédéric (2004) Polices entre État et marché, Paris, Presses de Sciences Po.
- Shapland, Johanna et Lode Van Outrive (1999) Police et sécurité: Contrôle social et interaction public/privé. Paris: L'Harmattan.
- Shearing, Clifford (1984) “La sécurité privée au Canada : quelques questions et réponses”. Criminologie, 17/1, 59-89.
- Shearing, Clifford et Philip Stenning (1985) “From the Panopticon to Disneyworld: The development of discipline.” In: Anthony N. Doob and Edward L. Greenspan (eds.), Perspectives in criminal law: Essays in honour John LL. J. Edwards. Aurora: Canadian Law Books: 335-348.
- Wood, Jennifer et Clifford Shearing (2007) Imagining security, Portland: Willan Publishing.
- Zedner, Lucia (2006) “Liquid security: Managing the market for crime control.” Criminology and Criminal Justice. 6/3: 267-288.
- Zedner, Lucia (2010) Security, London : Routledge.
Émeutes en France
Publié par BD-SLL
Le mot Émeute provient du verbe Émouvoir. Du haut Moyen Age à la Renaissance, une Esmote désigne une émotion collective prenant la forme d’un soulèvement populaire spontané. « Tumulte séditieux, soulèvement dans le peuple », indique le Dictionnaire de l’Académie française au milieu du 18ème siècle. Et le sens ne variera jamais.
Les émeutes françaises contemporaines ont lieu dans les quartiers populaires d’habitat collectif frappés par la désindustrialisation et le chômage, habités massivement par des familles d’ouvriers et d’employés dont beaucoup proviennent des grands flux migratoires des années 1950-1970 (Portugais, Maghrébins puis Noirs Africains) qui s’y sont installées avec la résorption des bidonvilles puis la politique du regroupement familial. Elles surviennent généralement à la suite de la mort d’un ou plusieurs jeunes du quartier concerné, le plus souvent en relations (diverses) avec une opération de police. Elles sont l’œuvre de garçons, grands adolescents et jeunes majeurs, souvent chômeurs ou inactifs, parfois ouvriers précaires ou apprentis, ou encore scolarisés dans les filières professionnelles les moins valorisées ; la plupart sont « issus de l’immigration » ; ils ne sont structurés par aucune organisation politique et n’affichent en apparence aucune revendication. Leur « répertoire d’action collective » (C. Tilly) réside principalement dans l’incendie de véhicules et l’affrontement avec les forces de l’ordre. Dans certains cas, les incendies visent aussi des bâtiments et certains magasins peuvent être pillés.
L’émergence
Le phénomène est apparu dans la seconde moitié des années 1970, dans certains quartiers pauvres de l’agglomération lyonnaise. Avec la médiatisation des événements du quartier des Minguettes à Vénissieux en juillet 1981, le phénomène apparaît aussi en région parisienne. L’émeute se fixe donc au tournant des années 1970 et 1980. Analysant cette époque, C. Bachmann et N. Leguennec (1996) écrivent : « Contre qui se battent les émeutiers ? Contre un ennemi sans visage. Contre ceux qui les nient quotidiennement, les condamnent à l’inexistence sociale et leur réservent un avenir en forme d’impasse. […] Aucun allié, aucune issue. L’univers symbolique des banlieues donne à lire un partage manichéen : les pauvres tristes et humiliés contre les riches puissants et enviés. […] S’il est une revendication qui s’affirme haut et clair, c’est bien celle d’une sensibilité à vif : obtenir un minimum de considération, bénéficier d’une reconnaissance, conquérir le respect. Ces deux sentiments forts, la sensation de l’impasse et la conscience du mépris, sont toujours à la racine des fureurs banlieusardes ».
Durant les années 1980, plusieurs phénomènes se conjuguent pour chasser l’émeute de la scène publique. D’abord la réaction du gouvernement (socialiste) de l’époque. Outre les opérations de prévention lancées l’été suivant, qui envoient plus de 100 000 jeunes des quartiers les plus « sensibles » en vacances ou bien les occupent sur place, plusieurs politiques publiques sont initiées en direction de l’insertion professionnelle, de l’école, de la prévention de la délinquance et de l’aménagement urbain. Le gouvernement a aussi libéré les ondes radiophoniques et ouvert aux étrangers la liberté d’association. Ensuite, un événement politique va ouvrir une perspective de reconnaissance symbolique pour ces jeunes « issus de l’immigration », au moment même où le racisme qu’ils dénoncent est comme consacré officiellement par l’émergence de l’extrême droite (le Front national) sur la scène électorale. Dans le même quartier des Minguettes, suite à une « bavure policière » qui menace de déclencher de nouveau l’émeute, des jeunes, fortement soutenus et conseillés par un prêtre, initient une nouvelle forme d’action collective : une grande marche non violente à travers la France. Cette « Marche des Beurs » connaîtra en 1983 un succès politico-médiatique important et suscitera une intense activité associative et politique encouragée en particulier par le Parti socialiste, qui suscite et contrôle la création de SOS Racisme.
L’enracinement
À l’enthousiasme de la première moitié des années 1980 va cependant succéder la désillusion. Tout d’abord, les politiques publiques initiées semblent impuissantes face à la montée du chômage de masse : de presque 500 000 chômeurs en 1974, on est passé à 2,5 millions en 1985. Dans les quartiers désindustrialisés, le taux de chômage des jeunes peu ou pas diplômés atteint 30% en 1990. Ensuite, sur le plan politique, le « mouvement Beur » n’a pas réussi à se structurer. Le besoin insatisfait de reconnaissance et de participation se mue alors en repli sur soi et en affirmation de sa différence hors du champ politique. La culture Hip-hop connaît un succès grandissant auprès de la jeunesse des quartiers, dont une partie opère progressivement un retour vers le religieux qui fait rapidement l’objet d’une désapprobation dans un pays structuré par une culture républicaine farouchement laïque. En 1989, éclate « l’affaire du foulard islamique » qui cristallise une nouvelle peur de l’Islam et isole politiquement encore davantage les descendants des immigrés Maghrébins désormais suspectés de « communautarisme ». La parenthèse du début des années 1980 est terminée. La violence émeutière va revenir en force et s’installer durablement dans la société française.
En l’espace de huit mois (d’octobre 1990 à mai 1991), une série d’émeutes éclatent, à Vaulx-en-Velin, Argenteuil, Sartrouville et Mantes-la-Jolie, et retentissent fortement dans le débat public. En comparaison avec l’été 1981, les rapports entre jeunesse des quartiers et police urbaine ont monté d’un cran dans la violence et l’émeute s’est aussi accompagnée de pillages et de dégradations importantes. Le « rodéo » semble désormais un euphémisme, le mot « émeute » s’impose dans le débat public et la comparaison avec l’Angleterre voire les États-Unis devient courante. Les syndicats de police font pression sur les pouvoirs publics et les médias, ils popularisent l’expression de « violence urbaine » [voir l’entrée dans ce dictionnaire] pour désigner un ensemble d’actes délinquants dont l’émeute ne serait qu’une forme, ils cherchent à accréditer l’idée de quartiers devenus des « zones de non droit » contrôlées par des trafiquants de drogues. Dans le champ politique, l’incompréhension voire la réprobation est d’autant plus grande que beaucoup de ces villes ont fait l’objet de politiques sociales et éducatives, mais sans avoir recherché davantage de participation et de démocratie locale, laissant donc aux habitants le sentiment que les choses se font sans eux. Le gouvernement, de nouveau socialiste, réagit en créant le ministère de la Ville et en faisant voter en 1991 une loi d’orientation sur ce qui s’appellera désormais « la politique de la ville » et ses « quartiers prioritaires ». Mais il renforce aussi le contrôle policier de ces territoires en créant une section des Renseignements généraux destinée à les observer et une nouvelle unité de choc de la police urbaine : les Brigades anti-criminalité (BAC). Par delà les alternances politiques, ces deux types de politiques publiques (ville et sécurité) guideront l’action des gouvernements jusqu’à nos jours, sans parvenir à renverser la donne. Depuis 1990, des émeutes locales ont éclaté quasiment chaque année.
La généralisation
Enfin, entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005, l’émeute perd son caractère localisé pour s’étendre à l’ensemble du territoire national. Pour la première fois, une émeute se déroulant dans un quartier d’une ville a des répercussions à des centaines de kilomètres, elle suscite un processus d’identification collective. Et dans la mesure où les télévisions montrent des voitures en feu depuis 25 ans, ce processus ne saurait s’expliquer par sa médiatisation. Durant trois semaines, des incidents – de gravité très diverse – surviennent dans près de 300 communes, occasionnant 10 000 incendies de véhicules particuliers et plusieurs centaines d’incendies ou de dégradations à l’encontre de bâtiments publics, notamment scolaires. La répression est lourde. La panique est telle au sommet de l’État que le Premier ministre décide de recourir au couvre-feu. Le 8 novembre, est décrété l’état d’urgence, en application d’une loi du 3 avril 1955, prise au temps de la Guerre d’Algérie.
Comment expliquer ce phénomène ? Les émeutiers interviewés dans la région parisienne donnent deux séries de raisons à leur colère (Mucchielli, Le Goaziou, 2007). Les premières sont relatives aux événements de Clichy-sous-Bois et à l’attitude des pouvoirs publics. C’est ce qui est considéré comme un déni et un mensonge de la part des autorités qui fonde l’indignation et donc le sentiment de légitimité morale de la colère émeutière. Les secondes raisons évoquent non pas le contexte de l’émeute mais certaines dimensions de l’expérience de vie quotidienne de ces jeunes, qui nourrit en profondeur « la rage » et « la haine ». Cette expérience révèle d’abord un vécu d’humiliations multiples accumulées. Viennent d’abord les souvenirs les plus forts. Certains racontent des expériences de discriminations à l’embauche, voire font du racisme une explication généralisée. La plupart font remonter leur sentiment d’injustice et d’humiliation à l’école. Enfin, tous disent que la source quotidienne de leur sentiment d’injustice et d’humiliation est leur relation avec la police, avec moult récits. Ensuite, en orientant l’analyse vers leurs conditions de vie générale, il apparaît que cette expérience est liée à l’absence de perspective d’intégration sociale, et d’abord au chômage dont le niveau n’a cessé d’augmenter durant les années 1990, creusant les écarts en fonction des niveaux de diplôme, maximisant les frustrations économiques et sociales des moins diplômés et accroissant le caractère durablement discriminatoire des parcours scolaires. Cette non insertion économique pèse sur l’ensemble du processus d’intégration sociale et d’entrée dans la vie adulte. Derrière l’absence d’emploi et donc de revenu, se profile en effet l’impossibilité matérielle du départ du domicile des parents pour accéder à un logement personnel ainsi que la difficulté objective à envisager une union conjugale et un projet familial. C’est l’ensemble de ce parcours conçu et attendu comme « normal » par tout jeune qui se trouve au mieux durablement contrarié, au pire perçu comme inaccessible. En d’autres termes, la non insertion économique n’est pas seulement une « galère » au quotidien, elle a des conséquences sur toute la perception de l’avenir et la vision du monde que se construisent les aînés ainsi que les cadets qui les observent. Enfin, elle a des répercussions au sein même des familles, sur les relations entre les générations. Dans cette colère vengeresse des jeunes durant les émeutes, que leurs parents et leurs grands frères disent souvent désapprouver sur la forme mais comprendre sur le fond, l’on peut lire ainsi une dimension plus collective encore.
L’émeute comme forme élémentaire de la protestation
Malgré cela, la violence n’est pas et n’a jamais été le seul langage pratiqué par cette jeunesse, pour peu qu’elle rencontre le soutien voire la collaboration d’autres forces sociales ou politiques. C’est dans les mêmes quartiers de la banlieue lyonnaise où s’inventèrent les émeutes à la fin des années 1970, que se développèrent des grèves de la faim et d’autres tentatives de mobilisations politiques des travailleurs immigrés (contre des agressions racistes, contre des violences policières, contre des expulsions, pour réclamer l’égalité des droits dans l’entreprise ou le droit de vote local), soutenues par les Églises et des associations militantes de gauche. C’est du même quartier émeutier des Minguettes qu’est parti le « Mouvement Beur » de 1982-83. Ceci révèle la nature « interpellative » de l’émeute, le besoin de reconnaissance qu’elle porte. Les émeutiers ne réclament aucune révolution, ils ne contestent pas le système social et politique, ils en dénoncent l’hypocrisie et les constantes humiliations ou « violences symboliques » (P. Bourdieu). Les protestations collectives ne traduisent pas seulement des conflits d’intérêts, elles portent aussi des attentes morales, des sentiments d’honneur collectif bafoué, de mépris et de déni de reconnaissance (A. Honneth). Contrairement à une peur croissante dans la société française, les émeutes contemporaines ne s’articulent pas sur un communautarisme ni sur une revendication d’autonomie par rapport aux règles démocratiques régissant la société globale. Les jeunes « issus de l’immigration », émeutiers comme non émeutiers, réclament non pas la possibilité de vivre selon des règles générales différentes de celles qui régissent la vie de la communauté nationale, mais le droit de participer pleinement à cette vie et à ces règles tout en étant reconnus et respectés dans leurs spécificités relatives.
Ainsi, l’émeute témoigne en creux de l’absence d’autres possibilités de contestation et pose in fine la question des médiations et de la représentation politiques. Par là, elle révèle le déficit de ces deux dimensions de l’intégration dans le système politique français. Déficit des médiations politiques entendues comme l’ensemble des interventions destinées à permettre un dialogue au besoin conflictuel entre les habitants de ces « zones urbaines sensibles » et les décideurs politiques ou administratifs. Les trois dernières décennies ont enregistré le déclin historique des formes d’encadrement et de politisation liées aux partis politiques, aux syndicats ainsi qu’aux mouvements de jeunesse et aux mouvements d’éducation populaire laïques ou religieux. Ceci n’empêche pas le secteur associatif d’être parfois dynamique, notamment à travers la politique de la ville, mais ces associations et les élites intermédiaires locales qu’elles pourraient faire émerger sont le plus souvent, soit maintenues en marge du jeu politique proprement dit, soit instrumentalisées dans le clientélisme municipal et dans un système d’« achat de la paix sociale ». Double déficit, ensuite, de demande et d’offre politiques. Outre que le droit de vote des étrangers non européens aux élections locales n’a jamais été décidé, l’échec du « mouvement Beur » des années 1980 puis la stigmatisation croissante des « arabo-musulmans » dans le débat politico-médiatique a éloigné cet électorat de la gauche dont il était le plus proche, puis l’a éloigné du vote tout court. Du côté de l’offre politique, le déficit d’intégration de représentants de ces populations dans les sections locales des partis et dans les équipes municipales au pouvoir est patent. Enfin, comme les réactions de la classe politique aux émeutes de 2005 l’ont montré, aucun parti ne se pose en défenseur des habitants des quartiers populaires. Le constat est massif du côté du Parti socialiste qui domine l’échiquier politique à gauche depuis vingt-cinq ans mais dont les militants comme les électeurs se sont progressivement coupés des milieux populaires. Mais il vaut également dans une large mesure pour les anciennes « banlieues rouges », ces villes ouvrières contrôlées politiquement durant des décennies par le Parti communiste. Il vaut enfin pour l’extrême gauche. De sorte que les électeurs Français « issus de l’immigration » ne trouvent nulle part sur l’échiquier politique le moyen de promouvoir leurs revendications ni même d’exprimer un équivalent du « vote protestataire » en faveur de l’extrême droite d’une partie des ouvriers « Français d’origine française ».
Septembre 2010
Références
Bachmann C. & Leguennec N., Violences urbaines, Albin Michel, Paris, 1996.
Beaud S. & Pialoux M., Violences urbaines, violence sociale, Paris, Fayard, 2003.
Kokoreff M., Sociologie des émeutes, Paris, Payot, 2008.
Lagrange H. & Oberti M., dir., Émeutes urbaines et protestations. Une singularité française, Paris, Les Presses de Sciences-Po, 2006.
Lapeyronnie D., « ‘Révolte primitive’ dans les banlieues françaises », Déviance et société, 4, 2006.
Lapeyronnie D., Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, Paris, Robert Laffont, 2008.
Mohammed M., « Les voies de la colère: ‘violences urbaines’ ou révolte d’ordre politique ? L’exemple des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne », Socio-logos, 2, 2007 [En ligne], URL : http://socio-logos.revues.org/document352.html
Mucchielli L. & Le Goaziou V., dir., Quand les banlieues brûlent. Retour sur les émeutes de novembre 2005, Paris, La Découverte, 2ème éd, 2007.
Prévention situationnelle
Publié par BD-SLL
L'histoire des détournements d'avions depuis les 50 dernières années offre un exemple de prévention situationnelle en action. Les fluctuations des détournements et des ripostes à ces crimes entre 1962 et aujourd'hui se sont succédées en sept étapes (voir Wilkinson 1986 et Clarke et Newman 2006). Première étape, durant les années 60, les autorités de l'aviation civile enregistrent dans le monde un nombre croissant de détournements d'avions. Le point culminant est atteint en 1969 : 70 détournements réussis et 12 tentatives. Les lignes aériennes américaines sont particulièrement frappées : 40 attentats. Deuxième étape, la riposte est internationale mais elle est particulièrement vigoureuse de la part des Américains. La mesure préventive principale prend la forme de fouilles pré-embarquement utilisant des détecteurs de métaux et le filtrage des passagers. Ces contrôles sont rendus obligatoires aux États-Unis en 1973. Troisième étape, on enregistre une forte baisse des détournements d'avions. En effet, durant les cinq années allant de 1968 à 1972, on comptait 147 détournements (réussis ou non). Durant les cinq années suivantes (1973 à 1977), ce chiffre tombe à 32. Par la suite le nombre de détournements oscille autour de 12 par année. Quatrième étape, les contrôles pré-embarquement se relâchent, particulièrement sur les lignes intérieures. Cinquième étape, lors des attentats du 11 septembre 2001, les terroristes d'Al-Qaida embarquent dans les vols domestiques armés de « box cutters », des couteaux utilitaires. À l'aéroport de Boston, dix terroristes passent l'examen du détecteur de métal et les rayons X sans éveiller les soupçons. À Washington, deux pirates de l'air déclenchent l'alarme. Les gardes les fouillent alors mais, curieusement, ils les laissent passer. Sixième étape, la mobilisation gigantesque qui a suivi ces attentats est bien connue. Les mesures de prévention sans doute les plus efficaces sont : le renforcement des contrôles de pré-embarquement; l’installation d'une porte blindée séparant les passagers du cockpit de pilotage, cette porte restant déverrouillée pendant le vol; la formation des agents de sécurité dans les aéroports ; l’utilisation de détecteurs d’explosifs et d’appareils de radioscopie. Septième étape, depuis, aucun autre attentat semblable à ceux du 11 septembre n'a été perpétré. Cependant nous savons que le réseau Al-Qaida dirige ses attaques ailleurs, notamment en Irak.
On entend par prévention situationnelle les modifications des circonstances particulières dans lesquelles des délits pourraient être commis afin qu’ils paraissent difficiles, risqués ou inintéressants pour qui serait tenté de les commettre [1].
Comme M. Jourdain faisait de la prose, nous faisons tous de la prévention situationnelle sans le savoir. Nous verrouillons nos portes, évitons les lieux malfamés, installons des systèmes d’alarme et plaçons notre argent à la banque ; nous évitons de laisser des objets de valeur dans notre voiture, de circuler dans les lieux dangereux, d'exhiber notre argent en public. Nous adoptons ces mesures de prudence dans le but de réduire la probabilité ou la gravité de nos victimisations.
Le gros du travail des employés en sécurité privée dont les effectifs sont, en Amérique du Nord, plus nombreux que ceux de la police, est assimilable à de la prévention situationnelle : gardiennage, installation d’alarmes, de détecteurs et de caméras, contrôles d’accès... Les policiers en tenue et les gendarmes peuvent être considérés comme des professionnels de cette forme de prévention quand ils patrouillent, surveillent, empêchent que les altercations ne dégénèrent et conseillent les victimes sur les moyens de se protéger.
La prévention situationnelle part du fait que quand il s'apprête à passer à l'action, le délinquant examine la situation pré-criminelle étant à l'affût de tout ce qui pourrait faciliter ou empêcher l'exécution du délit qu’il projette de commettre. Cet examen lui fait estimer ses chances de réussir son coup sans se faire prendre. S'il constate que la situation devant laquelle il se trouve a été aménagée de manière à rendre les délits trop difficiles, trop risqués ou peu profitables, il renoncera tout simplement. Ainsi les terroristes ne tentent plus de détourner des avions : trop difficile, trop risqué.
La prévention situationnelle s'affirme en rupture avec les solutions préventives et thérapeutiques favorisées traditionnellement en criminologie. Plutôt que de faire porter l’effort sur les prédispositions individuelles à la délinquance, on pèse sur les décisions des délinquants par le biais des situations. L’action est spécifique : elle prend pour cible un type très particulier de délit, par exemple le vol de livres dans une bibliothèque, et consiste à modifier les données du problème qui se pose à celui qui serait tenté de le commettre.
Clarke et ses collaborateurs ont dressé une liste de 25 techniques de prévention situationnelle qui donne une excellente idée de la diversité des moyens susceptibles de faire reculer un délinquant sur le point de passer à l'acte (Clarke et Eck 2003 ; Clarke 2005 et www.popcenter.org).
25 techniques de prévention situationnelle
Augmenter les difficultés
1. Durcir la cible
2. Contrôler les accès
3. Filtrer les sorties
4. Détourner les délinquants
5. Contrôler les armes et les outils
Augmenter les risques
6. Garder
7. Surveiller
8. Réduire l'anonymat
9. Poster un garant des lieux
10. Embaucher un surveillant
Réduire les gains
11. Dissimuler la cible
12. Enlever la cible
13. Identifier les propriétés
14. Perturber les marchés
15. Priver des gains du crime
Éviter de provoquer
16. Réduire la frustration et le stress
17. Éviter les disputes
18. Réduire les tentations et l'excitation
19. Neutraliser la pression des pairs
20. Décourager l'imitation
Éliminer les excuses
21. Édicter des règles
22. Afficher les instructions
23. Éveiller la conscience
24. Aider à la conformité
25. Contrôler la drogue et l'alcool
Il est possible de proposer une classification plus parcimonieuse qui nous permet de passer de 25 à 8 catégories de mesures situationnelles (Cusson 2007):
1 / Les surveillances et vérifications. Les situations dans lesquelles des infractions pourraient être commises sont soumises à une observation attentive et à des contrôles. Les contrevenants, sentant que les risques d’être surpris la main dans le sac sont élevés, renonceront – espère-t-on – à leur projet. Les acteurs sociaux qui sont chargés de missions de surveillance sont nombreux : policiers, gardiens mais aussi concierges, pions et vendeurs dans les boutiques. Ils y sont de plus en plus aidés par les systèmes électroniques : caméras, alarmes, détecteurs... Les surveillances et vérifications augmentent les probabilités que les transgressions soient sanctionnées ; elles font savoir que la règle est en vigueur ici et maintenant.
2 / Les protections physiques sont des dispositifs matériels conçus pour faire obstacle aux malfaiteurs et pour mettre les personnes et les biens à l’abri des attaques ou des vols. Pour faire reculer les délinquants devant la difficulté, on leur oppose des portes solides, des clôtures, des murs, des coffres-forts, des antivols...
3 / Les contrôles d’accès et de sortie font en sorte que les gens qui entrent ou sortent d’un site le fassent en conformité avec les règles et procédures en vigueur. On laisse entrer les personnes autorisées et on refoule les intrus, les gens armés, etc. On s’assure que les clients ne sortent pas d’un magasin avec des articles volés. Les systèmes modernes de contrôle d’accès combinent les appareils électroniques, l’informatique et l’intervention humaine.
4 / Les contrôles des moyens et de l’information sont les mesures tendant à limiter l’accessibilité aux armes, substances et outils qui facilitent l’exécution du délit ou le passage à l’acte. Pensons aux lois sur les armes à feu et à celles qui interdisent la vente de l’alcool aux mineurs.
5 / Les détournements sont les mesures par lesquelles on empêche des délinquants potentiels d’entrer en contact avec des victimes ou des cibles. On modifie les trajets des uns ou des autres ; on aménage les horaires pour éviter les contacts prolongés entre les uns et les autres ; on sépare les adversaires. Par exemple, un plan d’urbanisme peut être conçu de manière à créer des cul-de-sac, les cambrioleurs devant faire un effort supplémentaire pour repérer leurs cibles.
6 / Les désintéressements sont les mesures visant à réduire ou annuler les gains espérés par les contrevenants. On évite de circuler les poches pleines d’argent. On marque les pièces des véhicules automobiles pour en empêcher la revente. On efface rapidement les graffitis pour priver leurs auteurs de la satisfaction de revoir leur « œuvre ». Par hypothèse, les délinquants renonceront à leur projet s’ils n’ont pas grand-chose à en tirer ; ils y perdront intérêt.
7/ Les alternatives offrent des solutions de rechange légitimes à l'infraction. La disponibilité des policiers qui répondent rapidement aux appels des citoyens apparaît dans plusieurs circonstances comme une alternative : plutôt que de recourir à la force pour se débarrasser de l'individu menaçant, le citoyen appelle la police.
8/ La cessation des hostilités vise à rétablir la paix en cas de conflit et réduire les provocations, les offenses ou les frustrations susceptibles de susciter des conflits et de nourrir la colère. Les policiers qui demandent à des noctambules de faire moins de bruit pour respecter le sommeil de leurs voisins pratiquent l'apaisement. Et quand ces mêmes policiers interviennent en pleine bagarre pour s'interposer et empêcher la continuation du combat, ils préviennent une possible ascension aux extrêmes.
Ces mesures visent à infléchir les choix des délinquants potentiels en 1. augmentant leurs risques ; 2. augmentant leurs difficultés ; 3. réduisant leurs bénéfices, 4. offrant une solution de rechange et, 5. en réduisant les provocations et les risques d'escalade.
Le crédit accordé de plus en plus par les criminologues à la prévention situationnelle tient largement aux démonstrations de son efficacité. En effet, elle a gagné ses lettres de noblesse à partir du moment où il est devenu incontestable que certaines modifications des situations précriminelles étaient suivies de réductions significatives du nombre des vols ou des agressions. C'est ainsi que durant les années 1970, Clarke et ses collaborateurs avaient constaté que l'installation de dispositifs antivols sur la colonne de direction des véhicules automobiles était suivie d'importantes diminutions du nombre de vols de véhicules. En 2009, Guerette, fait un bilan systématique des évaluations rigoureuses de mesures de prévention situationnelle publiées en anglais. Il en trouve 206. Parmi celles-ci, 154 (75 %) aboutissent à la conclusion que l'intervention examinée fut efficace ; 24 (12 %) se révélaient inefficaces et, dans 28 autres études (14 %) les résultats restaient ambigus ou non significatifs. Il est vrai que les chercheurs ont tendance à publier des évaluations qui concluent au succès et qu'ils renoncent à publier des autres. Pour autant, le bilan de Guerette fait constater que, dans 154 cas, il fut avéré que des projets de prévention situationnelle bien conçus et correctement mis en oeuvre avaient fait reculer la délinquance prise pour cible.
Les principales techniques de prévention situationnelle évaluées répertoriées par Guerette se distribuent comme suit : 1/ des mesures visant à renforcer la surveillance par des agents de sécurité ou par des policiers : 44 % ; 2/ des mesures d'aide à la surveillance naturelle (par exemple l'éclairage qui améliore la visibilité des lieux exposés) : 28 % ; 3/ les protections physiques : 24 % ; des mesures, comme l'habitude de circuler dans la rue accompagné, qui assurent une meilleure protection des personnes ou des biens : 22 %; les contrôles d'accès : 18 % ; le recours à un garant des lieux, comme un concierge: 8 %.
Guerette et Bower 2009 ont repris le même corpus de 206 évaluations solides pour étudier la question du déplacement et celle de son contraire, la diffusion des bénéfices de la prévention. On sait que le déplacement s'observe quand une activité délinquante prévenue en un lieu donné réapparaît non loin de là, durant un autre moment ou sous une autre forme. Le phénomène inverse que l'on appelle la diffusion des bénéfices se produit quand l'observateur constate que l'activité délinquante n'est pas seulement prévenue dans l'endroit pris pour cible mais aussi dans des secteurs environnants (voir Clarke et Weisburd 1994). Parmi les 206 études évaluatives passées en revue par Guerette et Bower, 102 examinaient les possibilités de déplacement ou de diffusion des bénéfices pour un total de 574 observations (une étude pouvant mesurer plusieurs effets possibles). Dans 26 % de ces 574 observations, les chercheurs constatent des effets de déplacement et, dans 27 % des cas, des effets de diffusion des bénéfices de la mesure préventive. De plus, dans tous les cas où un déplacement est observé, il n'est jamais de 100 % ce qui laisse toujours un bénéfice net de la mesure préventive (voir aussi Hesseling 1994).
Comment expliquer le phénomène de la diffusion des bénéfices ? Il repose probablement sur l’incertitude dans laquelle sont plongés les délinquants sur l'étendue des risques auxquels ils s'exposent. Ils ignorent la portée d'une mesure comme la surveillance et ils ont tendance à en exagérer l'étendue.
Une série de six propositions théoriques peuvent être déduites des résultats de ces études évaluatives. Elles portent sur le processus de prise de décision des délinquants ; sur les facteurs dont ils tiennent compte et sur la manière dont ils s'adaptent à leur environnement.
1/ Les résultats encourageants de ces nombreuses évaluations jettent le doute sur la conception positiviste du passage à l’acte selon laquelle les criminels seraient puissamment déterminés par l'effet de causes comme la sous-culture, l'impulsivité ou la pauvreté. En effet, si des intervenants parviennent à faire reculer la délinquance simplement en éliminant des occasions, c'est que le penchant au crime n'est pas irrépressible. L’hypothèse du déterminisme des prédispositions criminelles est donc récusée.
2/ Les évaluations dont il a été question un peu plus haut nous apprennent que les voleurs et autres délinquants se retiennent de passer à l'acte quand ils se sentent surveillés ; quand ils se heurtent à des difficultés d'exécution ou quand les bénéfices escomptés leur paraissent insuffisants. Cela pourrait vouloir dire qu'ils sont gouvernés par ce que l'on pourrait appeler une rationalité du moment présent, c'est-à-dire par l'anticipation des conséquences immédiates de l'acte projeté. S'agissant du long terme, c'est un fait que la plupart des délinquants persistants ne prennent pas en compte les conséquences lointaines de leurs délits et aiment croire qu'ils échapperont à la prison. Mais ils ne sont pas insensés au point de se jeter dans la gueule du loup quand le loup y est.
3/ Par sa nature même, la mesure situationnelle est rapprochée du lieu et du moment où se décide le passage à l'acte. On en déduit le principe de la proximité spatio-temporelle : plus l'intervention est rapprochée dans le temps et l'espace de la décision de commettre une infraction, meilleures sont ses chances de la prévenir ou d’en empêcher l'aggravation. La proximité spatio-temporelle de l'intervention est cruciale, parce que c’est au moment même où il se demande s'il passera à l'action qu'il importe d'exercer une influence sur le délinquant.
4/ L'efficacité probante des mesures de protection physique, de contrôle d'accès et des détournements valide négativement le principe de la convergence de Felson (2002) selon qui le délit est rendus possible par la rencontre dans le temps et dans l'espace d'un délinquant motivé et d'une cible intéressante en l'absence de gardien.
5/ Le fait que les cas de déplacements avérés n'apparaissent que dans le quart des observations scientifiques réfute l'idée reçue selon laquelle les occasions seraient innombrables et également distribuées dans l'espace physique et social. En effet si elles l’étaient, le déplacement serait monnaie courante et il ne serait pas loin de 100 %. Car les délinquants confrontés à un dispositif situationnel aurait beau jeu d'aller sévir ailleurs. Pourquoi le déplacement n'est ni très courant ni jamais total? Parce que, quand les occasions sont bloquées en un lieu donné, il ne sera pas facile pour les délinquants d’en trouver d'autres. Qui plus est, les occasions criminelles très intéressantes sont non seulement inégalement réparties, mais aussi rares. Tout simplement, parce que les gens s’efforcent de bien protéger leurs biens les plus précieux en ayant recours à des portes solides, à des coffres-forts, des systèmes d'alarme et à d’autres dispositifs situationnels qui raréfient les aubaines criminelles.
6/ En dernière analyse, les succès de la prévention situationnelle apportent la preuve que les délinquants s'adaptent aux situations qu'ils rencontrent : aux occasions, aux difficultés, aux risques. Ils choisissent la ligne d'action qui leur permet de réaliser un gain immédiat ou de résoudre un problème. Par exemple, les sondages internationaux de victimisation établissent que plus les gens laissent souvent leur appartement inoccupé pendant la journée, plus ils s'exposent à être cambriolés (Killias 2001: 305) : les cambrioleurs se sont adaptés une évolution sociale qui conduit les hommes et les femmes à quitter leur domicile pour aller travailler en s'introduisant dans les logements durant le jour. L'art de la prévention devient l'art de reconfigurer les situations de manière à canaliser l'adaptation des délinquants dans le sens du renoncement au passage à l'acte.
[1] La définition proposée par Clarke (1992, 1997, 2005) est la suivante : “ La prévention situationnelle désigne les mesures de réduction des occasions qui sont : 1 / dirigées vers des types très particuliers de délits ; 2 / consistent en des modifications des circonstances immédiates du délit systématiques et permanentes ; et 3 / visent à rendre les délits plus difficiles, plus risqués, moins gratifiants et moins excusables pour bon nombre de délinquants. ”
Juin 2010
Lien internet
www.cops.usdoj.gov
Références
- Clarke, R. V. (dir.) (1992). Situational Crime Prevention. Successful Case Studies. New York: Harrow and Heston.
- Clarke, R. V. (dir.) (1997). Situational Crime Prevention. Successful Case Studies, 2nd edition. Guilderland, New York: Harrow and Heston.
- Clarke, R. V. (2005). Seven misconceptions of situational crime prevention. In Tilley, N. dir. 2005. Handbook of Crime Prevention and Community Safety. Cullompton, Devon : Willan.
- Clarke, R. ; Eck, J., 2003. Become a Problem-Solving Crime Analyst. Londres: Jill Dando Institute of Crime Science.
- Clarke, R. V.; Newman, G. R. (2006). Outsmarting the Terrorists. Westport Connecticut: Praeger Security International.
- Clarke, R. V.; Weisburd, D. (1994). "Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement", In R.V. Clarke (ed), Crime Prevention Studies, vol. 2, New York, Willow Tree Press, 165-184.
- Cusson, M., (2002). Prévenir la délinquance: les méthodes efficaces, Paris : Presses Universitaires de France (2e édition : 2009).
- Cusson, M. (2007). La prévention : les principes et la prévention policière. Cusson, M.; Dupont, B.; Lemieux, F. (Dir.). Traité de sécurité intérieure. Montréal : Hurtubise HMH (réédition aux Presses de polytechniques et universitaires romandes, 2008).
- Felson, M. 1998. Crime and Everyday Life, 2nd edition. Thousand Oaks, California : Pine Forge Press. (third ed.: 2002).
- Guerette, R. T. (2009). The Pull, Push, and Expansion of Situational Crime Prevention Evaluation: an Appraisal of Thirty-Seven Years of Research. In Knutsson, J. ; Tilley, N. Evaluating Crime Reduction Initiatives, Crime Prevention Studies, Vol. 24, p.29-58.
- Guerette, R. T; Bower, K. J. (2009). Assessing the extent of crime displacement and diffusion of benefits: a review of situational crime prevention evaluations. Criminology, vol 47, n. 4, p. 1331-1368.
- Hesseling, R. B. P. (1994). Displacement: A Review of the Empirical Literature. in Clarke, R.V. (ed) Crime Prevention Studies. vol. 3. Monsey N.Y.: Criminal Justice Press.
- Killias, M. (2001). Précis de criminologie. Deuxième édition. Berne. Staempfli.
- Scott, M. S. 2001. Robbery at to Automated Teller Machines. Problem-Oriented Guides for Police. Washington, DC: US Department of Justice. Office of Community Oriented Policing Services. www.cops.usdoj.gov.
- Wilkinson, P. (1986). Terrorism and the Liberal State. Londres: Macmillan.
Développement de l'agressivité physique depuis la jeune enfance jusqu'à l'âge adulte
Publié par BD-SLL
Introduction: Les croyances traditionnelles
- La violence physique chez les adolescents et les jeunes adultes suscite de vives préoccupations dans toutes les sociétés modernes. En effet, le risque d'être arrêté et trouvé coupable d'un acte criminel est plus élevé à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte qu'à tout autre moment de la vie. Au cours des 40 dernières années, des centaines d'études ont tenté de mieux comprendre comment des enfants enjoués deviennent de jeunes délinquants violents. La liste des facteurs associés à la délinquance juvénile violente comprend la surveillance inadéquate des enfants de la part des parents, la dislocation de la famille, l'influence négative des pairs et la pauvreté (McCord et al., 2001; Lipsey et Derzon, 1998).
- La majorité des personnes arrêtées pour crime violent sont de sexe masculin.
- L’explication principale des comportements violents a longtemps été la suivante : « les comportements agressifs et violents sont des réponses apprises par la frustration, ils peuvent aussi être appris en tant qu’instruments destinés à atteindre des buts, et l’apprentissage se produit en observant des modèles de ce type de comportement. Ces modèles peuvent être observés dans la famille, chez les pairs, ailleurs dans le quartier, dans les médias de masse, ou dans la pornographie violente » (Reiss et Roth, 1993).
Le problème des croyances traditionnelles
Si l'agressivité physique est apprise en observant les modèles au sein des familles, dans les quartiers et chez les pairs, on peut poser les questions suivantes :
- Quand est-ce que cet apprentissage commence?
- La fréquence des actes d'agressivité physique augmente-t-elle à la suite de l'exposition à des modèles de comportement agressif?
- Quand et comment peut-on prévenir le développement de l'agressivité physique?
Résultats des études récentes
a) La recherche à l’école primaire
Jusqu’à tout récemment, la plupart des études sur les comportements agressifs ont été centrées sur les adolescents et sur les adultes. Une minorité d'études longitudinales réalisées à partir de grands échantillons d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire constitue une grande source d'information sur le développement de l'agressivité physique (Tremblay, 2000; Tremblay et Nagin, 2005). Un résultat significatif et inattendu de ces études longitudinales est le fait que chez la vaste majorité des enfants, la fréquence des agressions physiques diminue entre le moment où ils commencent l'école et celui où ils terminent l'école secondaire. Le phénomène se présente autant chez les filles que chez les garçons, bien que les fréquences des agressions physiques étaient systématiquement plus faibles chez les filles. Ce phénomène a été observé dans les années 1980 et 1990 au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis où le taux d’homicides était en augmentation (Cairns et al., 1989; Broidy et al., 2003; Nagin et Tremblay, 1999).
Cette diminution de la fréquence des actes d'agressivité physique avec l'âge était inattendue du point de vue de la théorie de l'apprentissage social de l’agression, puisqu'en vieillissant les enfants étaient exposés à un nombre toujours croissant de modèles d'agressivité physique. Des études longitudinales ont également montré qu'il est fort peu probable qu'un adolescent qui n'a pas été très agressif physiquement par le passé se mette tout à coup à présenter de sérieux problèmes d'agressivité physique (Broidy et al., 2003; Nagin et Tremblay, 1999; Brame et al., 2001; Barker et al., 2007; Loeber et al., 2005).
Ces découvertes nous amènent évidemment à nous poser une autre question : si la plupart des enfants atteignent leur fréquence la plus élevée d’agressions physiques lorsqu'ils commencent à aller à école, quand est-ce que les enfants apprennent à agresser d'autres personnes physiquement? Jusqu’à présent, peu de chercheurs se sont penchés plus particulièrement sur l'agressivité physique avant l'arrivée à l'école, sans doute pour trois bonnes raisons : (1) les conséquences des agressions physiques perpétrées par un adolescent de 18 ans sont généralement plus dramatiques que les agressions physiques perpétrées par un trottineur de 3 ans; (2) la théorie de l'apprentissage social de l'agression nous a amenés à croire que les enfants apprennent à agresser pendant leurs années à l'école parce qu'ils sont plus exposés aux modèles d'agression que les enfants d'âge préscolaire; (3) il est plus facile pour les chercheurs d'observer et d'interviewer les enfants d'âge scolaire.
b) La recherche durant la petite enfance
Au cours des dix dernières années, quelques études longitudinales qui ont permis de suivre les enfants depuis la naissance ont renversé notre opinion du développement de l’agressivité physique. Ces études montrent que si les enfants apprennent effectivement à agresser physiquement en observant des modèles, l'apprentissage se fait sans doute en majeure partie entre les 18 et 24 premiers mois après la naissance. En fait, la plupart des mères ont dit que leurs enfants avaient recouru à une forme ou à une autre d'agression physique quand ils avaient cet âge (Tremblay et al., 1999; Alink et al., 2006). Ceci dit, il y a des différences importantes quant à la fréquence des agressions physiques chez les petits enfants et chez les trottineurs (Côté et al., 2006; Liben et Bigler, 2002; Tremblay et al., 2004). Ces études montrent qu’une majorité d’enfants ont occasionnellement recours à l’agressivité physique, qu’une minorité y a recours beaucoup moins souvent que la majorité, et qu’une autre minorité utilise cette agressivité beaucoup plus souvent que la majorité. Beaucoup d’enfants d’âge préscolaire sont orientés vers des cliniques pour des problèmes de comportement, principalement parce qu’ils manifestent des comportements d’agressivité physique (Keenan et Wakschlag, 2000).
Les données disponibles sur le développement de l'agressivité physique pendant les années préscolaires indiquent que la fréquence des actes d'agression physique augmente chez la plupart des enfants pendant les 30 à 42 premiers mois après la naissance pour diminuer de manière constante par la suite (Côté et al., 2006; Liben et Bigler, 2002; Tremblay et al., 2004). Moins de filles que de garçons atteignent les niveaux de fréquence les plus élevés, et les filles ont tendance à réduire la fréquence de leurs actes d'agression plus tôt dans la vie (Côté, 2007).
Par ailleurs, les études longitudinales qui se poursuivent jusqu’à l’adolescence montrent que la période préscolaire est une période charnière pour ce qui est de l'apprentissage de la régulation de l'agression physique. En effet, la minorité des enfants à l'école primaire (de 5 % à 10 %) qui continuent à manifester des niveaux élevés d'agression physique présentent le risque le plus élevé de se livrer à des comportements de violence physique pendant l'adolescence (Broidy et al., 2003; Nagin et Tremblay, 1999).
Il est intéressant de noter que la fréquence des agressions physiques diminue à partir de la troisième ou la quatrième année après la naissance, alors que la fréquence des gestes d'agressivité indirects (propos désobligeants à l’insu de la personne visée) augmente de façon importante entre quatre et sept ans et que les filles ont tendance à user de cette forme d'agressivité plus souvent que les garçons (Côté et al., 2007).
Les principaux facteurs de risque qui font que les femmes peuvent avoir des enfants qui éprouvent de graves problèmes d’agressivité sont les suivants : un faible niveau d’études, une histoire de problèmes de comportement, une première grossesse à un jeune âge, la consommation de tabac pendant la grossesse et de faibles revenus (Côté et al., 2006; Liben et Bigler, 2002; Tremblay et al., 2004; Nagin et Tremblay, 2001; Keenan et Shaw, 1994). Les résultats d'une étude récente sur un important échantillon de jumeaux semblent également indiquer qu'il y a une dimension génétique dans les différences individuelles quant à la fréquence des agressions physiques à l'âge de 19 mois (Dionne et al., 2003).
Conclusions
Contrairement aux croyances traditionnelles, les enfants n'ont pas besoin d'observer des modèles d'agression physique pour commencer à user de ce genre de comportement. En 1972, Donald Hebb a fait remarquer que les enfants n'ont pas besoin d'apprendre à faire une crise de colère (Hebb, 1972). Dans son livre de 1979 sur le développement social, Robert Cairns a rappelé à ceux qui étudient le développement humain que les animaux agressifs étaient dans la plupart des cas ceux qui ont été isolés dès la naissance (Cains, 1979). Les petits enfants semblent spontanément recourir à l'agression physique pour atteindre leurs objectifs quand ils sont fâchés. À la suite des travaux novateurs de Charles Darwin, Michael Lewis et ses collègues ont montré qu'on observe des réactions de colère dès l'âge de 2 mois (Lewis et al., 1990; Lewis et al., 1992). Aussi les enfants semblent-ils spontanément jouer à se battre (Peterson et Flanders, 2005). Ainsi, plutôt que d'apprendre à recourir à l'agression physique par l’intermédiaire de leur environnement les enfants apprennent à ne pas recourir à l'agression physique grâce à divers types d’interactions avec leur environnement.
Les études sur le développement de l'agressivité pendant les années préscolaires n'ont pas encore élucidé de manière adéquate les mécanismes qui expliqueraient :
- pourquoi certains petits enfants sont plus physiquement agressifs que d'autres;
- pourquoi certains se livrent très peu à des formes d'agression physique;
- pourquoi les petites filles tendent à se livrer moins souvent à des formes d'agression physique que les petits garçons;
- pourquoi la plupart des enfants apprennent à réguler leurs comportements d’agressivité physique avant de commencer à aller à l'école;
- pourquoi certains enfants ne l'apprennent pas;
- pourquoi certains enfants commencent à se livrer à des formes d'agression indirecte;
- pourquoi les filles se livrent davantage à des formes d'agression indirecte que les garçons;
- dans quelle mesure le recours à l'agression indirecte réduit l'agressivité physique;
- ce qu'on peut faire pour aider les enfants d'âge préscolaire qui éprouvent des difficultés à apprendre à contrôler leur tendance à devenir plus physiquement agressifs.
Implications pour la prestation de services et pour l'élaboration des politiques
Les études précitées ont deux implications importantes pour la prévention de l'agression physique. Il y a d'abord le fait que la plupart des enfants acquièrent d'autres moyens d'expression que l'agression physique pendant leurs années préscolaires. Par conséquent, cette période de l'enfance est sans doute la plus favorable aux interventions visant à aider les enfants qui risquent de devenir des agresseurs physiques chroniques à apprendre à réguler leur comportement. Le soutien intensif destiné aux familles à risques élevés, qui commence pendant la grossesse, devrait avoir des effets à long terme (Côté et al., 2007; Olds et al., 1998; Schweinhart et Xiang, 2003). Ensuite, comme la plupart des êtres humains ont eu recours à une forme ou à une autre d'agression physique pendant leur jeune enfance, la plupart courent probablement le risque d'y recourir de nouveau s'ils se trouvent dans une situation qui ne semble offrir aucune autre solution satisfaisante. Ceci expliquerait pourquoi tant de crimes violents sont commis par des gens qui n'ont pas d'antécédents d'agression physique chronique, et pourquoi tant de conflits entre familles, groupes ethniques ou religieux, classes socio-économiques et nations conduisent à l'agression physique.
Les politiques qui favorisent une éducation de qualité pendant la jeune enfance devraient réduire l'incidence des cas de violence chronique de même que le niveau général d'agression physique au sein de la population. Mais il faut aussi des politiques qui cherchent à maintenir des environnements empreints de paix partout dans la société pour empêcher que des réactions agressives primitives ne percent la mince couche de civilité que nous acquérons en vieillissant.
Note
Cette entrée a été initialement publiée dans : Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, Boivin M, eds. Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants [sur Internet]. Montréal, Québec: Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants; 2008:1-7. Disponible sur le site: http://www.enfant-encyclopedie.com. Reproduite avec l'autorisation de l'auteur.
Références
- Alink LRA, Mesman J, Van Zeijil J, Stolk MN, Juffer F, Koot HM, Bakermans-Kranenburg MJ, Van IJzendoorn MH. The early childhood aggression curve: Development of physical aggression in 10-to50-month-old children. Child Development 2006;77(4):954-966.
- Barker ED, Séguin JR, White HR, Bates M, Lacourse E, Carbonneau R, Tremblay RE. Developmental trajectories of male physical violence and theft: Relations to neurocognitive performance. Archives of General Psychiatry 2007; 64(5):592-599.
- Brame B, Nagin DS, Tremblay RE. Developmental trajectories of physical aggression from school entry to late adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 2001;42(4):503-512.
- Broidy LM, Nagin DS, Tremblay RE, Brame B, Dodge K, Fergusson D, Horwood J, Loeber R, Laird R, Lynam D, Moffitt T, Bates JE, Pettit GS, Vitaro F. Developmental trajectories of childhood disruptive behaviors and adolescent delinquency: a six-site, cross-national study. Developmental Psychology 2003;39(2):222-245.
- Cairns RB, Cairns BD, Neckerman HJ, Ferguson LL, Gariépy JL. Growth and aggression, I: childhood to early adolescence. Developmental Psychology 1989;25(2):320-330.
- Côté SM. Sex differences in physical and indirect aggression: A developmental perspective. European Journal of Criminal Policy and Research 2007;13(3-4):183-200.
- Côté SM, Boivin M, Daniel DS, Japel C, Xu Q, Zoccolillo M, Junger M, Tremblay RE. The role of maternal education and nonmaternal care services in the prevention of children's physical aggression problems. Archives of General Psychiatry 2007;64(11):1305-1312.
- Côté S, Vaillancourt T, Leblanc JC, Nagin DS, Tremblay RE. The development of physical aggression from toddlerhood to pre-adolescence: A nation wide longitudinal study of Canadian children. Journal of Abnormal Child Psychology 2006 ;34(1) :68-82.
- Côté SM, Vaillancourt T, Barker ED, Nagin DS, Tremblay RE. The joint development of physical and indirect aggression: Predictors of continuity and change during childhood. Developmental Psychopathology 2007;19(1):37-55.
- Dionne G, Tremblay RE, Boivin M, Laplante D, Pérusse D. Physical aggression and expressive vocabulary in 19 month-old twins. Developmental Psychology 2003;39(2):261-273
- Hebb DO. A textbook of psychology. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 1972.
- Cairns RB. Social development: the origins and plasticity of interchanges. San Francisco, CA: WH Freeman & Co; 1979.
- Keenan K, Shaw DS. The development of aggression in toddlers: a study of low-income families. Journal of Abnormal Child Psychology 1994;22(1):53-77.
- Keenan K, Wakschlag LS. More than the terrible twos: The nature and severity of behavior problems in clinic-referred preschool children. Journal of Abnormal Child Psychology 2000;28(1):33-46.
- Lewis M, Alessandri SM, Sullivan MW. Violation of expectancy, loss of control, and anger expressions in young infants. Developmental Psychology 1990;26(5):745-751.
- Lewis M, Sullivan MW, Ramsay DS, Alessandri SM. Individual differences in anger and sad expressions during extinction: antecedents and consequences. Infant Behavior and Development 1992;15(4):443-452.
- Liben L, Bigler R, eds. The developmental course of gender differentiation: conceptuality, measuring and evaluating constructs and pathways. Malden, Mass : Blackwell Publishing; 2002. Monographs of the Society for Research in Child Development.
- Lipsey MW, Derzon JH. Predictors of violent or serious delinquency in adolescence and early adulthood: a synthesis of longitudinal research. In: Loeber R, Farrington DP, eds. Serious and violent juvenile offenders: risk factors and successful interventions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 1998:86-105.
- Loeber R, Lacourse E, Homish DL. Homicide, Violence and Developmental Trajectories. In Tremblay RE, Hartup WW, Archer J, eds. Developmental origins of aggression. New York, NY : Guilford Press; 2005:202-219.
- McCord J, Widom CS, Crowell NA, eds. Juvenile crime, juvenile justice. Washington, DC: National Academy Press; 2001.
- Nagin D, Tremblay RE. Trajectories of boys' physical aggression, opposition, and hyperactivity on the path to physically violent and nonviolent juvenile delinquency. Child Development 1999;70(5):1181-1196.
- Nagin DS, Tremblay RE. Parental and early childhood predictors of persistent physical aggression in boys from kindergarten to high school. Archives of General Psychiatry 2001;58(4):389-394.
- Peterson JB, Flanders JF. Play and the regulation of aggression. In Tremblay RE, Hartup WW, Archer J, eds. Developmental origins of aggression. New York, NY : Guilford Press; 2005:133-157.
- Olds D, Henderson CR, Cole R, Eckenrode J, Kitzman H, Luckey D, Pettitt L, Sidora K, Morris P, Powers J. Long-term effects of nurse home visitation on children's criminal and antisocial behavior: Fifteen-year follow-up of a randomized controlled trial. JAMA-Journal of the American Medical Association 1998;280(14):1238-1244.
- Reiss AJ Jr, Roth JA, eds. National Research Council (U.S.). Panel on the Understanding and Control of Violent Behavior. Understanding and preventing violence. Vol 1. Washington, DC: National Academy Press; 1993:7.
- Schweinhart L, Xiang Z. Evidence that the High/Scope Perry Preschool Program prevents adult crime. Paper presented at: The 2003 American Society of Criminology Conference. November, 2003; Denver, CO.
- Tremblay RE. The development of aggressive behaviour during childhood: what have we learned in the past century? International Journal of Behavioral Development 2000;24(2):129-141.
- Tremblay RE, Japel C, Pérusse D, McDuff P, Boivin M, Zoccolillo M, Montplaisir J. The search for the age of “onset” of physical aggression: Rousseau and Bandura revisited. Criminal Behavior and Mental Health 1999;9(1):8-23.
- Tremblay RE, Nagin DS, Séguin JR, Zoccolillo M, Zelazo PD, Boivin M, Pérusse D, Japel C. Physical aggression during early childhood: Trajectories and predictors. Pediatrics 2004;114(1):e43-e50.
- Tremblay RE, Nagin DS. The Developmental Origins of Physical Aggression in Humans. In Tremblay RE, Hartup WW, Archer J, eds. Developmental origins of aggression. New York, NY : Guilford Press; 2005:84-106.



